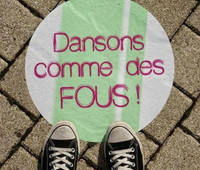En 2025, plus d'une personne sur deux vit dans un pays où la liberté de la presse est gravement menacée, ça représente 4,25 milliards de personnes à travers le monde. C'est ce que révèle le dernier classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Dans de nombreux pays du monde aujourd'hui, journalistes, lanceurs d'alerte et défenseurs des droits humains sont pris pour cibles, notamment quand ils travaillent sur les questions environnementales ou la corruption.
Aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur eux passent aussi par le droit et c'est ce dont on parle avec Sophie Lemaître, docteure en droit et autrice de "Réduire au silence, comment le droit est perverti pour bâillonner médias et ONG", paru aux éditions Rue de l'Échiquier.
A noter que le 7 octobre à 19h, Sophie Lemaître sera à la maison Les Canaux à Paris, en compagnie de Reporters sans frontières et Amnesty International.
Infos et inscriptions : Débat "Réduire au silence : quand le droit à l’information est menacé"
LSH : Sophie, dès l'introduction de votre livre, vous parlez du lawfare, que vous qualifiez d'arme de dissuasion massive. Alors déjà, qu'est-ce que ce lawfare ?
SL : Le lawfare, c'est un concept qui nous vient des anglophones qui veut dire la "guerre par le droit". Si c'est une arme de dissuasion massive, c'est parce que les différentes dimensions du droit vont être utilisées pour empêcher l'information d'être publiée.
Une des facettes du lawfare, c'est les poursuites judiciaires. Une autre, c'est d'adopter de nouvelles lois dans un but d'intimidation. Par exemple en France, on a adopté la loi sur le séparatisme en 2021 et on a introduit le contrat d'engagement républicain.Dans le cadre du lawfare, l'idée est d'utiliser, d'interpréter les lois d'une certaine manière pour empêcher les journalistes ou les défenseurs de de l'environnement d'agir.
LSH : Dans votre livre vous donnez de nombreux nombreux exemples, notamment celui de Daphne Caruana Galizia, journaliste assassiné à Malte en 2017 et vous expliquez que quand des meurtres comme celui-ci sont perpétrés, bien souvent les responsables bénéficient d'une forme d'impunité.
SL : Chaque année des journalistes sont assassinés dans le monde. Pour l'année 2024, Reporters sans frontières a recensé une cinquantaine de journalistes tués. En Europe, on n'a pas non plus été épargnés. Vous l'avez citée, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia en 2017, mais en 2018, le journaliste slovaque Jan Kuciak a aussi été assassiné, et d'autres journalistes en Grèce, aux Pays-Bas etc.
Ce qu'on voit, c'est que assassinats sont liés au travail que ces journalistes menaient. . En Europe, lorsqu'il y a eu des assassinats, il y a eu des enquêtes qui ont été menées.
Dans le cas de Daphne Caruana Galizia par exemple, on a retrouvé les intermédiaires, il y a eu des condamnations mais pour autant, le cerveau de l'affaire n'a pour l'instant pas été condamné. Cela crée un climat d'impunité, avec le risque que d'autres assassinats aient lieu.
LSH : Dans le cadre de ces meurtres de journalistes, vous mentionnez l'importance de se fédérer avec notamment l'exemple du collectif Forbidden Stories, un réseau international de journalistes qui a pour mission de poursuivre les enquêtes d'autres reporters qui ont été réduits au silence.
SL : C'est essentiel parce que ça envoie un message à la fois à ceux qui s'attaquent aux journalistes mais aussi aux journalistes eux-mêmes. Si on poursuit en diffamation un journaliste, on envoie aussi le message que si les autres journalistes décident de travailler sur ce sujet-là, ils risquent aussi d'être poursuivsi. Si un journaliste est assassiné, on envoie le message que si on travaille sur ce sujet-là, on risque aussi d'être assassiné.
Le mantra, la philosophie de Forbidden stories, c'est "tuer le messager ne tuera pas le message"
Forbidden Stories a créé une boîte sécurisée, qui s'appelle le Safe Box Network et qui permet aux journalistes d'y mettre leur travail, de le placer en sécurité et si jamais il leur arrivait quoi que ce soit, une arrestation, une poursuite en justice ou malheureusement un assassinat, le collectif va reprendre le travail et ce sera publié dans des dizaines de pays.
Dans le cas de Daphne Caruana Galicia, son travail a été publié dans une quarantaine de pays.
Il existe aussi d'autres collectifs : l'ICIJ, le Consortium International des journalistes d'investigation ou l'OCCRP. Il y a plein de collectifs de journalistes qui existent et qui permettent aux journalistes de travailler ensemble sur des enquêtes, de les publier et qu'ils ne soient pas seuls face aux risques qu'ils encourent.
LSH : Les journalistes sont donc parfois tués dans l'exercice de leurs fonctions et pour les réduire au silence, il existe aussi ce qu'on appelle les poursuites bâillons.
SL : Il faut savoir qu'il n'y a pas de définition unique de ce qu'est une poursuite bâillon, mais on a un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre de savoir ce que c'est. Déjà, une poursuite bâillon prend l'apparence d'une procédure légitime classique mais le souci, c'est qu'elle a pour objectif d'empêcher les journalistes de faire leur travail.
Alors comment est-ce qu'on peut savoir si on est face à une poursuite bâillon, et bien il y a plusieurs aspects : est-ce qu'il y a une forme de communication publique ? Un article par exemple qui est publié sur un sujet d'intérêt public. Est-ce que le rapport de force est déséquilibré ? Par exemple une entreprise qui fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires et un tout petit média. Est-ce que c'est le journaliste qui est poursuivi ou son média ? Est-ce que l'entreprise qui lance l'action judiciaire multiplie les recours ? Est-ce qu'elle va épuiser toutes les voies de recours ? Est-ce qu'elle va lancer une action au civil, au pénal ?
La procédure bâillon prend plusieurs formes et la poursuite en diffamation, c'est vraiment la poursuite bâillon par excellence. Mais il y a aussi d'autres fondements qui vont être utilisés.
Donc on va avoir des journalistes, des médias ou des ONG qui vont être poursuivis en dénigrement pour violation de la vie privée, pour non respect du règlement général sur la protection des données personnelles, pour atteinte au secret des affaires.
Peut-être un exemple marquant, l'ONG Greenpeace a été poursuivi aux États-Unis par une entreprise pétrolière, au titre du RICO Act qui est une législation américaine qui vise à lutter contre le crime organisé.
On reprochait à Greenpeace d'être une organisation criminelle parce qu'ils auraient soutenu des peuples autochtones qui manifestaient contre la construction d'un pipeline par cette par cette entreprise. En mars 2025, Greenpeace a été condamné à verser 666 millions de dollars de dommages et intérêts à l'entreprise. On voit bien l'impact de ces poursuites en termes de montant. Mais également, ça signifie que pendant tout le temps de la procédure, le journaliste ne va pas pouvoir faire son travail parce qu'il doit dédier son temps à se défendre et il ne peut pas enquêter.
LSH : On a donc parlé des acteurs privés, des entreprises, mais il s'agit de dire que les états aussi ont tout un arsenal qui leur permet de museler les journalistes, les médias ou les associations.
SM : Les techniques utilisées par les états sont différentes parce qu'ils ont tout un arsenal législatif à leur disposition. Ils vont utiliser par exemple les lois sur la cybercriminalité, sur les fake news, la diffusion de fausses informations, les lois sur les bonnes mœurs, sur la sécurité nationale, le terrorisme, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale. Il y a deux chefs d'accusation qui sont très souvent utilisés contre les journalistes, c'est le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale.
On voit aussi que dans certains pays où le système judiciaire n'est pas indépendant, il y a des dossiers qui vont être montés de toute pièce, on va avoir des journalistes qui vont être accusés de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale ou d'autres crimes alors qu'en fait il s'agit de représailles parce qu'ils ont révélé des pratiques de corruption par exemple au sein du gouvernement.
LSH : Alors finalement, qu'est-ce qui peut être mis en place concrètement contre ces poursuites bâillons ? À quelle échelle ça se joue ?
SM : On peut adopter des lois pour lutter contre les procédures bâillons comme au Canada ou aux Etats-Unis. Au niveau européen, on a eu une directive, adoptée en 2024, qui vise à lutter contre les procédures abusives ou manifestement infondées. Les États-membres ont jusqu'à mai 2026 pour transposer la directive, c'est-à-dire pour que ce qui est prévu dans la directive fasse partie du cadre juridique national.
Pour ce qui est de cette directive, c'est un pas important, mais elle a beaucoup de limites parce qu'elle ne se concentre que sur les poursuites qui ont lieu en matière civile ou commerciale. Or les poursuites bâillons, dans leur grande majorité, se font en matière pénale. Aussi, cette directive ne concerne que les poursuites transfrontalières, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un élément étranger.
Donc si c'est une entreprise française et un journaliste français sur le sol français, selon la directive, les procédures, les garanties qui sont prévues ne s'appliquent pas.
A titre individuel, en tant que citoyen, on peut aussi agir. Quand vous voyez un journaliste qui raconte qu'il a été poursuivi en justice, relayez l'information. Suivez des médias indépendants. Certains médias ont même lancé des cagnottes de financement participatif parce que les poursuites bâillons coûtent extrêmement cher. Si vous en avez la possibilité, faites des dons.
LSH : Il s'agit aussi de dire que la justice, à travers les avocats et les magistrats, peut aussi subir des attaques.
SM : En France, les avocats sont encore relativement épargnés, même si on a vu qu'il y avait des magazines d'extrême droite, des médias d'extrême droite, qui avaient publié une liste d'avocats à abattre.
On a aussi une avocate qui a récemment été poursuivie en diffamation alors qu'elle défendait une association environnementale .A la suite de la condamnation de Nicolas Sarkozy fin septembre, on a vu un déchaînement de menaces et de haine à l'encontre des magistrats alors qu'ils ne font qu'appliquer le droit. Si on n'a plus les avocats pour défendre les journalistes ou les associations, et si on n'a plus les magistrats pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'impunité, alors l'état de droit il n'est plus et démocratie non plus.
Un entretien mené par Lolla Sauty-Hoyer.