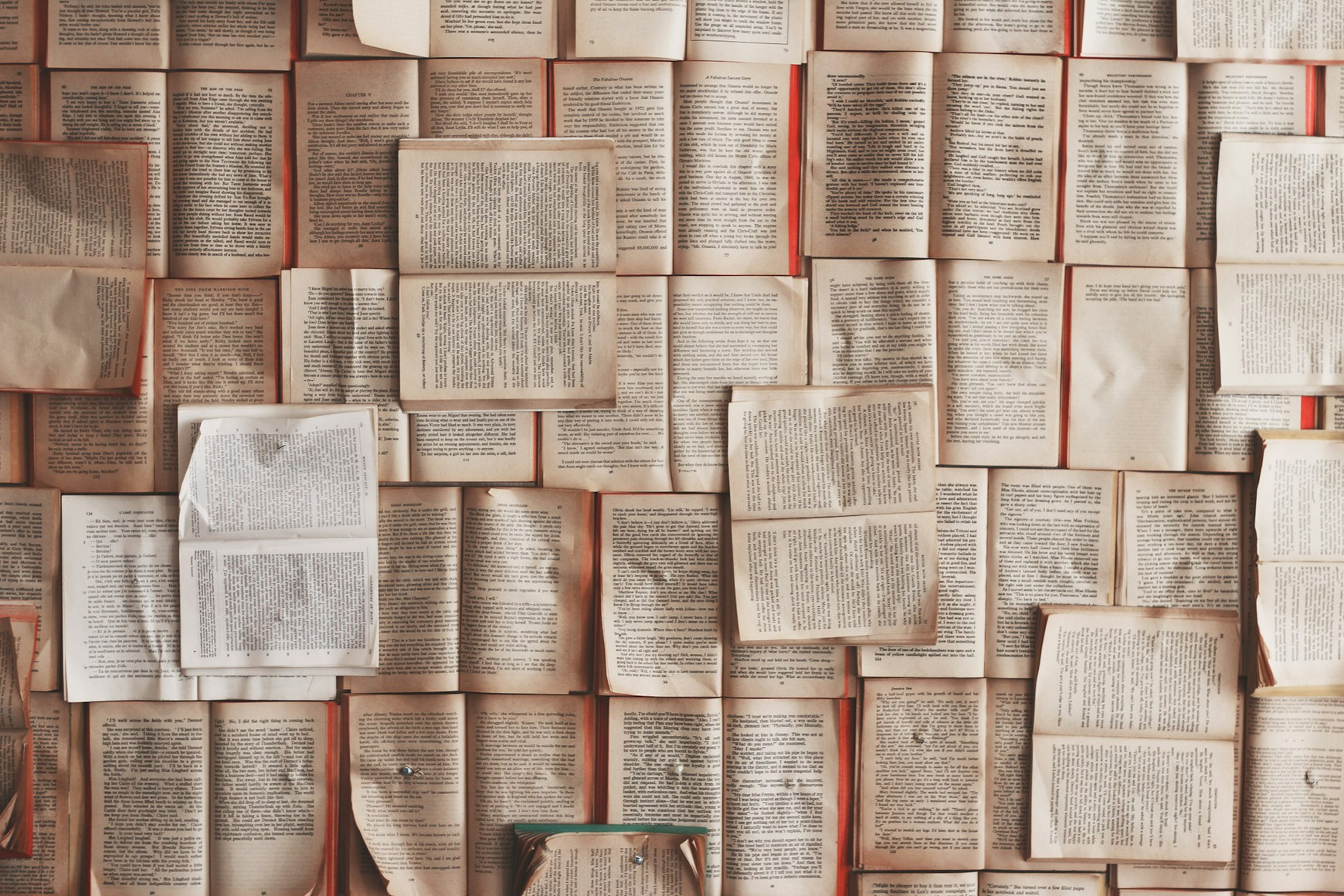
Chaque semaine, Quentin Dickinson revient sur des thèmes de l'actualité européenne sur euradio.
Cette semaine, Quentin Dickinson, vous voulez évoquer un livre…
Le roman crypto-autobiographique de Roger PEYREFITTE, intitulé La Fin des ambassades, décrit par le menu l’ambiance oppressante des années 1930 finissantes et des jeunes années 1940 au cœur de la diplomatie française. Y domine le sentiment de l’inévitable affrontement armé, planant au-dessus des mondanités de rigueur et des tâches du quotidien, accomplies méticuleusement comme si de rien n’était, alors que l’action diplomatique se trouve marginalisée, à l’heure des discours belliqueux sur fond de bruits de bottes, d’incidents de frontière, et de combats provisoirement distants.
Publié huit ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale , La Fin des ambassades, sans doute quelque peu oublié aujourd’hui, est un saisissant portrait d’un milieu instruit en permanence d’une actualité à la brutalité croissante, sur laquelle il n’a nullement prise, et qui s’enferme dans une élégante résignation.
Mais pourquoi donc avez-vous sorti cet ouvrage de votre bibliothèque, Quentin Dickinson ?...
Tout simplement parce qu’il correspond assez bien à l’état d’esprit qui se répand aujourd’hui dans les chancelleries des pays européens. Le contexte nous est familier : la Russie ne cache plus guère ses intentions malveillantes à l’égard de l’Europe, et le propos et la terminologie du Kremlin d’aujourd’hui reproduisent assez exactement celles de BERLIN en 1939 : les ‘causes profondes’ invoquées sont identiques ; elles seraient provoquées par l’injustice supposée d’une guerre perdue vingt-cinq ans auparavant, par la perte de territoires qui en fut la conséquence, et par la volonté d’effacer cette injure historique par la reconquête des dits territoires.
Ce constat est presque banal, tant il est évident. Mais il y a davantage.
Qu’entendez-vous par là ?...
Le tout récent Sommet européen de COPENHAGUE en est un lamentable exemple. Les échanges entre chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne étaient exclusivement consacrés à l’accroissement continu de la menace russe ; or, cette réunion qualifiée d’urgente s’est terminée sans conclusion aucune, si ce n’est de vagues engagements à refaire le point, une fois qu’on aura travaillé un peu plus les options proposées.
Quelques jours auparavant, la ville de COPENHAGUE, son aéroport, plaque tournante de l’ensemble de l’Europe du Nord, et sa principale base militaire où sont formées des unités des forces ukrainiennes, avaient été survolés plusieurs heures durant par des drones russes.
Or, au Sommet, il s’est avéré impossible de trouver une position commune des Vingt-sept sur la pertinence d’abattre ou non ces aéronefs – sur le réarmement de l’UE, il a fallu constater une fracture entre les pays en première ligne et ceux qui sont d’avis que leur éloignement de la frontière russe les met à l’abri, alors que le soutien financier à l’Ukraine aura, une fois de plus, été bloqué par le Hongrois Viktor ORBÁN et son complice, le Slovaque Robert FICO.
De fumeux débats ont bien eu lieu sur la définition de ce qui pourrait constituer une dissuasion crédible pour l’avenir. Nous sommes censés nous en satisfaire, alors que chaque jour se multiplient les survols de notre espace aérien, les violations de nos frontières, les sabotages de nos câbles de télécommunication sous-marins et de nos infrastructures ferroviaires et énergétiques, les cyberattaques contre nos services publics et nos industries.
On conçoit que le triste charivari de COPENHAGUE fasse sourire à MOSCOU.
Mais le climat délétère du moment a aussi une autre origine, Quentin Dickinson…
L’incapacité des Européens à s’unir contre les menées russes s’explique aussi par leur incertitude quant au soutien militaire qu’ils escomptent de la part de WASHINGTON. Il est vrai que la situation n’est pas la même si l’UE doit financer seule l’endiguement des actions hostiles de la Russie. Le paradoxe, c’est que les Européens en ont les moyens, tant militaires que financiers, mais tant que chacun joue sa partition, le concert reste inécoutable.
Curieusement, l’OTAN continue de fonctionner comme auparavant et l’implication des forces américaines en Europe reste inchangée, en tout cas, pour l’heure.
Loin des plateaux de télévision et des discours des politiques, les militaires poursuivent discrètement leur travail de coordination, de prévision, et de riposte.
Voilà au moins une considérable consolation, au moment où s’approche – peut-être – une nouvelle fin des ambassades.
Un entretien réalisé par Laurence Aubron.






