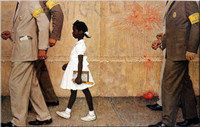Avec sa chronique Les femmes ou les "oublis" de l'Histoire, Juliette Raynaud explore "les silences de l'Histoire" (Michelle Perrot) et nous invite à (re)découvrir notre matrimoine oublié, une histoire après l'autre...
« Je suis convaincue que tous les événements terribles dans le monde débutent par de simples actes de lâcheté. »
Vous connaissez Adélaïde Hautval ? Elle fut arrêtée en avril 1942 pour n’avoir pas su accepter l’inacceptable. Déclarée « amie des Juifs », elle fut condamnée à « partager leur sort ». Elle est déportée à Auschwitz-Birkenau. Parce qu’elle ne laissait rien passer. Parce qu’elle était debout. Elle fut parmi les premières à recevoir, en 1965, le titre de Juste parmi les Nations.
Adélaïde (Haïdi pour ses amies et la postérité) naît le 1er janvier 1906 en Alsace annexée par l’Allemagne impériale. Après la Première Guerre Mondiale, son père, Philippe Haas, pasteur de l’Eglise réformée et patriote français demande à changer de nom et, francisant celui de son village d’origine, obtient de s’appeler Hautval.
Adélaïde est parfaitement bilingue. Elle joue aussi très bien du piano. Après des études à Strasbourg, elle obtient son diplôme et devient médecin psychiatre en 1934. Elle se spécialise en psychiatrie infantile et, avec son frère et sa soeur, elle crée un institut pour « enfants nerveux » dans son village natal.
En 1939, au moment où la guerre est déclarée, elle est évacuée dans le Périgord, comme une partie de la population alsacienne. Elle trouve une place d’interne dans un hôpital sur la ligne de démarcation puis, en décembre 1941, un poste à l’hôpital psychiatrique de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées.
Elle est arrêtée au printemps 1942 pour franchissement illégal de la ligne de démarcation et écope d’une peine à la prison de Bourges.
Quelques jours après son arrestation, une femme rejoint sa cellule. Elle porte une étoile jaune. Scandalisée par ce marquage, elle s’en fabrique une en papier. En représailles, un commandant de la Gestapo la déclare « Amie des Juifs » et la condamne à « partager leur sort puisqu’elle les aime tant ». Elle est internée au camp de Pithiviers et doit porter l’étoile jaune ainsi qu’une bande de tissu blanc portant l’inscription « Amie des Juifs ».
Au camp, elle fait fonction de médecin, elle assiste aux départs et aux arrivées des interné·es. Quelques jours après la « Rafle du Vél’ d’Hiv’ », le 2 août 1942, les parents sont séparés des enfants pour être envoyés aux camps nazis. Le commandant du camp, un policier français et débordé, lui demande « d’user de son influence auprès des mères pour leur dire que leurs enfants les rejoindront bientôt ». Dans la lettre de la préfecture qu’il lui montre, elle lit : « Les parents sont envoyés à l’avance pour préparer le camp. La plus grande sollicitude sera mise en oeuvre pour que les conditions de vie de ces enfants soient les meilleures possibles ».
Et le jour arrive où les enfants, eux aussi, doivent partir, tout seuls, avec quelques femmes.
Fin septembre, elle est transférée avec les interné·es juif·ves de Pithiviers encore présent.es, au camp de Beaune-la-Rolande puis, à la prison d’Orléans et enfin au fort de Romainville. Elle est internée dans une salle qui rassemble des « criminelles »
d’horizons divers tandis qu’à côté sont rassemblées des communistes. Des liens se créent entre les deux salles.
« C’est avec intensité que nous écoutons Marie-Claude Vaillant-Couturier nous lire la Déclaration des droits de l’homme… Il y a désormais entre nous quelque chose de solide, nous nous sommes rencontrées au-delà des divergences. Nous pensons que, même si nos voies sont différentes, nous avons suffisamment de convictions communes pour travailler loyalement ensemble, dans un même but, pour le respect de la dignité humaine. »
Adélaïde Hautval part de Gare de l’Est le 24 janvier 1943 dans le convoi dit des « 31 000 », celui de Danielle Casanova, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Charlotte Delbo et tant d’autres : direction Auschwitz-Birkenau.
Elle porte le matricule 31 802.
Médecin prisonnière, elle est chargée des sélections : les SS lui demandent de déterminer si les déportées sont trop malades ou trop faibles pour travailler. Sélectionnées, elles partent directement à la chambre à gaz.
« J’ai refusé d’écrire ‘incapable de travailler’’ sur aucun rapport médical. »
Elle est d’abord affectée au Revier de Birkenau, l’infirmerie du camp, puis au Block 10 d’Auschwitz, où des centaines de femmes juives de différentes nationalités servent de cobayes à des expériences pseudo-médicales.
Adélaïde Hautval refuse avec obstination de participer à ces opérations au risque de sa propre condamnation à mort. Elle s’efforce de soigner ces femmes qu’on stérilise brutalement, qu’on torture, elle s’interdit de déclarer les cas de typhus et cache des détenues dans des recoins des dortoirs, à l’étage où les médecins nazis ne vont jamais.
« La seule chose qui nous reste à faire est de nous comporter en êtres humains. »
A force d’insubordination, elle est condamnée à mort et renvoyée à Birkenau pour exécution. Elle y échappe grâce à l’intervention de la responsable de l’infirmerie de Birkenau, une déportée communiste allemande, qui lui administre un somnifère et la fait passer pour morte.
Oubliée pendant quelques mois, elle reprend ses fonctions de médecin au Revier de Birkenau – les SS ont besoin d’elle. Transférée à Ravensbrück, elle s’efforce jusqu’à la fin de sauver des détenues épuisées en les maquillant et en falsifiant leurs feuilles de température lors des sélections.
À la libération du camp par les Russes, elle reste volontairement plusieurs semaines pour soigner les femmes trop faibles pour être transportées, avec Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui dira d’elle : « Haïdi, c’est une conscience ».
Une rue de Bourges porte son nom.