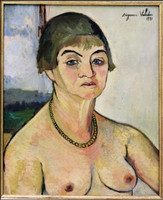Avec sa chronique Les femmes ou les "oublis" de l'Histoire, Juliette Raynaud explore "les silences de l'Histoire" (Michelle Perrot) et nous invite à (re)découvrir notre matrimoine oublié, une histoire après l'autre...
Vous connaissez Alice Guy ?
On lui doit le cinéma, le cinéma de fiction, le fait que le cinéma raconte des histoires. Elle fut la première productrice de cinéma de fiction, directrice de studio, réalisatrice, scénariste. Elle réalisa aussi le premier "making-of" et le premier péplum de l’Histoire. Elle fut aussi la première à faire jouer des acteur·rices noir·es, en 1912, dans son film A fool and his money.
Alice Guy naît en 1873 à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Son père est un éditeur chilien et elle reçoit une éducation bourgeoise et interculturelle. Elle traverse l’Atlantique sur un paquebot à 4 ans. Puis, revenue en France, direction le couvent. Elle est polie et bien élevée... mais c’est une aventurière.
A 21 ans, elle est engagée comme secrétaire de direction au Comptoir Général de la Photographie. Elle travaille pour Léon Gaumont, un employé plein d’avenir qui rachète la compagnie et la rebaptise l’année suivante. Elle assiste à ses côtés à la première projection privée d’Auguste et Louis Lumière. Les deux frères projettent des images animées sur un drap blanc. Le cinématographe est né.
Alice a lu, rêvé, voyagé. Elle a envie d’autre chose que de ces images qui se contentent d’imprimer le réel. Elle veut utiliser le cinématographe pour raconter des histoires :
« Timidement, je proposai à Léon Gaumont d’écrire une ou deux scénettes et de les faire jouer par des amis. Si on avait prévu le développement que prendrait l’affaire, je n’aurais jamais eu son consentement. Je l’obtins à la condition expresse que cela n’empiète pas sur mon travail de secrétaire… »
L’année suivante, en 1896, à Belleville, avec quelques amis, un pied photo et un décor découpé dans du carton, Alice Guy réalise La Fée aux Choux, un court-métrage d’une minute qui s'attaque avec humour aux stéréotypes de genre : on y voit une jeune femme qui extirpe des bébés de choux géants. C’est le premier film de fiction de l’Histoire (et une critique mordante du patriarcat).
Léon Gaumont la nomme rapidement directrice des studios et lui confie les vues animées de fiction. Scénarios, casting, décors, costumes, lumière, prises de vue, mise en scène, elle supervise toutes les étapes de la création. Elle perfectionne les trucages et colorise les images.
Dès 1902, elle associe des images animées et le phonographe : Phono-scène fait d’elle une pionnière du cinéma parlant. A cette occasion, elle réalise le premier "making-of" de l'Histoire : Alice Guy tourne une phonoscène.
C’est aussi elle qui invente le péplum en 1906 avec son premier long métrage La Vie de Jésus Christ : 600 mètres de pellicule, 25 tableaux, 300 figurants. La même année, elle réalise Les Résultats du Féminisme : à nouveau elle joue avec les stéréotypes et inverse les rôles genrés : on voit des hommes changer les couches de leurs bébés, pousser des landaus, tricoter ou coudre à la machine, tandis que les femmes paressent en lisant le journal, en buvant l’apéro et en houspillant les hommes.
Après avoir réalisé des centaines de films, Alice quitte la France pour les Etats-Unis en 1907, avec son jeune époux opérateur chez Gaumont, Herbert Blaché. Elle crée Solax Films Co. qui deviendra en 4 ans la société de production la plus importante du pays, avant l’essor d’Hollywood.
En 1912, elle réalise A Fool and His Money, le premier film avec un casting noir (les acteur·rices blanc·hes ont refusé d'y participer).
Riche, au sommet de sa (courte) gloire et toujours à la pointe de l'innovation, Alice Guy fait construire des studios de plus en plus grands. Jusqu’à la première guerre mondiale, elle écrit, dirige et produit plus de 350 films.
Son influence et son œuvre sont considérables (un millier de films en 20 ans) et inspira les plus grand·es. Pourtant, c'est ruinée qu'elle reprend le bateau pour la France avec ses deux enfants, en 1922. Elle ne parvient pas à retrouver ses films qu’elle voit d’autres s’approprier. Ignorée par le 7e art et ses historiens, l'hommage que lui rend (finalement) la Cinémathèque en 1957 n'y change rien. Ses Mémoires ne trouveront un éditeur qu’en 1976, près de 10 ans après sa mort.