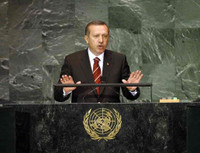Aujourd'hui en Europe est un journal consacré aux actualités européennes du jour, réalisé par la rédaction d'Euradio à Bruxelles. Avec Thomas Kox, Baptiste Maisonnave, Paul Thorineau et Ulrich Huygevelde.
Au programme :
- La flottille humanitaire pour Gaza attaquée, l’Europe réagit
- L’Ukraine souhaite vendre des armes, testées et approuvées
- Une étude sur le cancer révèle une multiplication des cas d’ici 2050
On commence ce journal en revenant sur la décision italienne, puis espagnole, de déployer chacun un navire de guerre pour venir en aide à la Global Sumud Flotilla, la flottille humanitaire en direction de Gaza. Les navires ont été la cible d’une attaque dans la nuit de mardi à mercredi, pour l’instant imputée à Israël.
Oui, pour rappel on parle des 51 navires qui se dirigent vers Gaza avec l’objectif de briser le blocus. A leur bord, des activistes de 45 pays, dont la suédoise Greta Thunberg.
Mardi 23 septembre, la flottille a été la cible de violentes explosions - aucun mort ni blessé - mais plusieurs bateaux ont subi des dommages L’attaque s’est produite au large de la Crète, en Grèce, et aurait duré plus de cinq heures. Cinq heures, en pleine nuit, pendant lesquelles des drones ont largué des charges explosives sur les navires.
Une situation inédite qui a poussé l’Italie à réagir.
Oui. Dès le lendemain, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a dépêché une frégate militaire. Objectif : « garantir l’assistance aux citoyens italiens présents sur la flottille ». L’initiative a trouvé un écho en Italie, où des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées lundi pour manifester leur soutien.
La Première ministre Giorgia Meloni, de son côté, a jugé cette mission « pas nécessaire », estimant que le gouvernement et les autorités compétentes auraient pu agir « en quelques heures ». L’Italie, qui ne reconnaît pas l’État de Palestine, a néanmoins annoncé le lancement d’une initiative diplomatique en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.
Et l’Italie n’est pas seule en Europe à s’être impliquée.
Oui l’Espagne a également envoyé un bâtiment militaire jeudi pour soutenir l’équipage, tandis que la Grèce est restée à l’écart. Pourtant, l’attaque a eu lieu à proximité de la Crète. Les garde-côtes n’ont pas bougé, ce que Marikaiti Stasinou, porte-parole de la délégation grecque de la flottille, a dénoncé comme « un grave manquement ». La Grèce, rappelons-le, ne reconnaît pas non plus l’État de Palestine.
La France enfin, qui co-présidait le sommet du 22 septembre sur la question de la reconnaissance de la Palestine, est restée passive. Le ministère des affaires étrangères a publié un communiqué mercredi, dans lequel il “condamne toute attaque”. Concernant les participants de la flottille, il rappelle qu’ils étaient “informés des risques encourus”.
En juin dernier déjà, plusieurs flottilles avaient tenté de rallier Gaza. Elles avaient été arrêtées par les forces israéliennes, et certains participants – dont l’eurodéputée LFI Rima Hassan – avaient été détenus plusieurs jours.
On poursuit ce journal à Kyiv, où un nouveau marché est en train de s’ouvrir : celui des exportations d’armes fabriquées en Ukraine et testées sur le champ de bataille. Une opportunité que le président Volodymyr Zelensky entend saisir pour transformer son industrie de défense.
L’annonce a été faite devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Elle met fin à une restriction liée à la loi martiale de 2022. Argument phare de Zelensky : « leur efficacité prouvée en défense réelle », notamment dans le domaine des drones, où l’Ukraine affirme produire plus de 4 millions d’unités par an.
Dans le même temps, l’Allemagne a confirmé être engagée dans une « course aux armements ». Son ministre de la Défense, Boris Pistorius, a présenté jeudi un projet d’investissement de 35 milliards d’euros dans la défense spatiale. Le chancelier Friedrich Merz a proposé, dans une tribune au Financial Times, de prêter 140 milliards d’euros à l’Ukraine en utilisant des actifs russes gelés.
Une évolution qui n’a évidemment pas échappé au Kremlin.
Non. Lors du G20, présidé cette année par l’Afrique du Sud, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé l’OTAN et l’Europe d’avoir « déclaré la guerre à la Russie ». Quelques jours plus tôt, le 15 septembre, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, affirmait déjà que l’Alliance atlantique était en guerre avec Moscou en raison de son soutien militaire à l’Ukraine.
Pourtant, mercredi à l’ONU, Volodymyr Zelensky a dénoncé l’inefficacité de l’organisation face aux conflits : « Que peuvent attendre le Soudan, la Somalie, la Palestine ou tout autre peuple en guerre ? Depuis des décennies, il n’y a que des déclarations ». Il a ajouté que, faute de retrait russe, les dirigeants du Kremlin pourraient devenir des « cibles légitimes ».
Enfin, un constat alarmant pour conclure ce journal : les décès liés au cancer devraient augmenter fortement d’ici à 2050. C’est ce qu’indique un rapport signé par 2 000 chercheurs et publié jeudi dans The Lancet.
D’ici 25 ans, 30,5 millions de personnes devraient être diagnostiquées d’un cancer, et 18,6 millions pourraient en mourir. Entre 1990 et 2023, le nombre de nouveaux cas a déjà presque doublé, atteignant 18,5 millions. Dans le même temps, la mortalité a grimpé de 74 %, avec 10,4 millions de décès en 2023.
Et dans le monde, les disparités sont nettes !
Oui dans les pays riches, le taux de mortalité a baissé de 33 %, tandis qu’il a augmenté de 14 % dans les pays à faibles ressources. Les chercheurs expliquent ces différences par l’accès limité aux soins et au personnel médical, et rappellent que d’ici 2050, les pays à faible ressources ou à revenu intermédiaire connaîtront plus de la moitié des nouveaux cas et les deux tiers des décès.
Enfin, près de 41,7 % des morts liées au cancer sont attribuables à des facteurs de risque modifiables : tabac, alcool, mauvaise alimentation ou excès de sucre, que l’on peut donc éviter.
Un journal de Baptiste Maisonnave, Ulrich Huygevelde et Paul Thorineau.