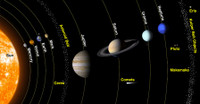Tous les mercredis, écoutez Iris Herbelot discuter d'un sujet du secteur spatial. Tantôt sujet d'actualité ou bien sujet d'histoire, découvrez les enjeux du programme européen Hermès, de la nouvelle Ariane 6, ou encore de la place de l'Europe dans le programme Artémis. Ici, nous parlons des enjeux stratégiques pour notre continent d'utiliser l'espace pour découvrir, innover, et se défendre.
La semaine dernière nous avons parlé de l’exploitation des ressources minières, quelles autres ressources y a-t-il à exploiter parmi les étoiles ?
Une ressource précieuse en ces temps géopolitiques troubles : l’énergie ! Et plus particulièrement, l'énergie solaire.
Contrairement au régolithe lunaire, ça on en a déjà sur Terre…
Oui, mais on a pas la même. L’énergie solaire sur Terre, qui est une excellente alternative aux énergies fossiles, arrive filtrée. Entre les nuages, la nuit et l’atmosphère qui nous protège nous humains des rayons ultra-violets, il n’y a qu’une petite portion du pouvoir gigantesque du soleil qui atteint les panneaux photovoltaïques sur Terre.
Donc mettre les panneaux solaires en orbite, ça permettrait de faire tourner en permanence à plein régime, sans barrière nuageuse, sans des heures nocturnes, sans couche d’ozone.
Quantitativement, quelle différence cela représente ?
En termes de chiffres, les estimations tournent autour de 120 terrawatts-heure par panneau solaire orbital. A titre de comparaison, la production totale mondiale d’énergie en 2023 était de 30 000 terrawatts-heure. Donc si on fait un calcul simple, il faudrait 250 stations solaires en orbite pour ne serait-ce qu’égaler la production actuelle, soit la taille d’une constellation satellitaire de communication commerciale, et là on parle d’un nombre pour alimenter la planète. Donc si chacun participe un peu, les coût sont risibles.
Sur la production, ce sont des chiffres énormes et délirants, mais ce qu’on peut se dire, c’est que les études des agences spatiales et des cabinets qui se sont penchés sur la question estiment que la production spatiale d’énergie solaire serait 40 fois supérieure à celle sur Terre.
Est-ce que des stations solaires existent déjà ?
Pour l’instant, seulement des tests de faisabilité ont déjà été faits, par la NASA au début des années 2020, et la JAXA, l’agence spatiale japonaise, a récemment transféré de l’énergie depuis l’espace vers la Terre, et devrait cette année faire une démonstration avec une station mise en orbite. La Chine a aussi lancé en janvier de cette année un programme pour construire une station solaire d’un kilomètre de long en orbite.
Quels sont les obstacles à ces structures ?
Déjà il faut assembler en orbite, ça nécessite beaucoup de lancements –donc d’avoir des lanceurs réutilisables pour que ça vaille le coup–, beaucoup d’argent, beaucoup de temps. Et ensuite, il faut amener toute cette énergie emmagasinée en orbite sur Terre. Ça c’est le point contentieux, mais les démonstrations sont de plus en plus prometteuses, et la technologie de transfert d’énergie par micro-ondes est de mieux en mieux maîtrisée, on en voit l’exemple avec les chargeurs non filaires de téléphones portables.
Est-ce que cela en vaut la peine ?
Oui pour plusieurs raisons : déjà, même si les énergies renouvelables comme l’énergie solaire sur Terre sont une très bonne alternative au pétrole, au gaz naturel et au charbon, l’énergie solaire spatiale serait encore plus propre et neutre en carbone, parce que sur le long-terme, elle annulerait et dépasserait son coût environnemental lié à la fabrication des panneaux photovoltaïques et des lancements pour les mettre en orbite.
Ensuite, parce que ça permettrait d’accroître l’indépendance énergétique des pays qui ne disposent pas de ressources en énergie fossile, typiquement, l’Europe. Hors on l’a vu avec la guerre en Ukraine, la dépendance au gaz russe est un talon d’achille dont les Européens ne se sont toujours pas défaits après trois ans de guerre, ils continuent d’acheter du gaz et du pétrole russe à des prix records et des quantités record, soit directement soit par des pays tiers. Avoir un accès à l’espace et des ressources technologiques suffisantes pour concevoir des stations solaires orbitales, c’est le cas de l’Europe, donc la prochaine étape, pour l’ESA c’est de réaliser un projet similaire, ce qui est étudié. Et même sans en faire une priorité, l’UE devrait s’y intéresser aussi, pour assurer son indépendance énergétique.
L’intérêt est donc écologique et géopolitique.
Il est aussi économique, pour les consommateurs. La stabilité de la production permettrait des prix fixes, bas, sur le long-terme. Et les usages de stations en orbite peuvent être plus larges que la production d’électricité : par exemple, des projets qui émergent depuis quelques années portent sur mettre en orbite les data centers qui stockent et traitent nos données numériques, puisque rien n’est jamais vraiment dématérialisé. Là encore on a un avantage écologique, puisque les data centers sont des sources énormes de pollution parce qu’ils chauffent beaucoup, consomment beaucoup d’énergie –et ça ne serait plus un problème en orbite–, et qu’ils consomment beaucoup d’eau pour leurs systèmes de refroidissement justement.
En plus, ça présenterait un intérêt stratégique, en plus de politique, parce que c’est des structures qui pourraient être des cibles moins faciles en orbite que les infrastructures sur Terre qui peuvent être ciblées par des frappes conventionnelles.
Un entretien réalisé par Laurence Aubron.