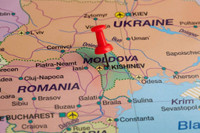Chaque semaine, Perspective Europe, l'association du master Affaires européennes de Sciences Po Bordeaux, revient sur l'actualité bruxelloise et européenne sur euradio avec Quoi de neuf à Bruxelles ?
Alors quels ont été les moments forts de la semaine qui vient de s'écouler ? On en discute tout de suite avec Fédor Dupont-Nivet. Bonjour et Bienvenue !
Eh bien pour commencer, venons-en à une déclaration qui a provoqué un grand soulagement chez de nombreux industriels, représentants des États membres, et des parlementaires : la commission européenne a effectivement promis de revenir sur l'objectif de baisse des quotas ETS prévu initialement en 2030. Rappelons que les quotas ETS, désignent les autorisations officielles d'émettre une quantité déterminée de gaz à effets de serre.
Mais pourquoi cette joie auprès de ces acteurs ?
Beaucoup d'industriels se sont longtemps plaint que le système de quotas était trop restrictif. En particulier le ciment, l'acier, l'aviation ou la chimie font face à des verrous technologiques. Une réduction des émissions de CO2 serait donc impossible sans suspendre certaines activités.
Cette déclaration ne marque donc pas un retour en arrière en matière de politique environnementale ?
D'une certaine manière oui, mais le numéro 1 de la DG Clima, Kurt Vandenberghe, a également souligné une volonté de changement d'une problématique : Le fait que seulement 5% des revenus des ETS sont aujourd'hui investis dans des technologies de décarbonation.
Comment compte il changer cela ?
Pour l'instant, 90% des recettes issus des enchères de quotas vont aux États membres, qui visiblement, n'ont pas eu la volonté de placer cet argent dans des technologies de décarbonation. Le commissaire a donc promis une part plus grande de ces recettes dans des projets au niveau européen, jugés plus fiables pour investir dans la décarbonation.
Deuxième actualité cette semaine, elle concerne cette fois la politique de compétitivité biotechnologique de l'UE. Pourquoi avoir choisi de parler de ce sujet ?
Effectivement, lorsque le thème de la compétitivité au niveau européen est abordé dans le débat public, des sujets comme la défense, l'industrie lourde ou le numérique nous viennent immédiatement en tête - Pour de bonnes raisons.
Cependant, le manque de compétitivité dans le domaine biotechnologique est également d'une importance capitale. Rappelons que la biotechnologie désigne selon l'OCDE l'application de la science aux organismes vivants pour produire des biens et des services. C'est une discipline qui est décisive pour les activités de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique alerte depuis de nombreuses années que sa capacité à innover se détériora si l'on agit pas bientôt sur la compétitivité dans ce domaine.
Elle est actuellement ralentie par deux facteurs: la fragmentation réglementaire et le retard d'investissement.
Si l'enjeu est aussi crucial, nos représentants européens ont surement déjà entam' des projets de loi ?
Effectivement, en ce moment, nous sommes témoins du Biotech Act, qui vise à créer un cadre européen cohérent pour les biotechnologies, et davantage d'investissements au niveau européen dans ce domaine.
Mais quand est-ce que le projet de loi sera finalisé ?
En soi, la commission prévoit l'application concrète dans un an, en octobre 2026. Cependant, certains facteurs pourraient ralentir son application.
Lesquels ?
Le premier dissensus porte sur la somme du budget de Recherche et développement dédié à la biotechnologie. La France, l'Allemagne et la Belgique optent pour une forte augmentation, en soulignant le fait que l'Europe a déjà accumulé un retard significatif par rapport à la Chine et les Etats-Unis, ayant récemment augmenté leurs budget pour la biotechnologie, creusant l'écart à 25 Milliards d'euros. D'autres pays, comme les Pays-Bas, l'Autriche et les États baltes, considèrent en revanche qu'une augmentation de ce budget pour la biotechnologie pourrait se faire au détriment des investissements communs nécessaires dans la défense, l'énergie ou l'agriculture.
Les désaccords portent également sur l'application de certaines technologies. Certains pays comme l'Italie, la Pologne ou l'Irlande bloquent la mise en marché de thérapies utilisant des technologies de modifications génétiques, pour des raisons religieuses ou morales liées à la protection de la vie embryonnaire.
Le projet de loi est donc loin d'être appliqué. La commission européenne, à l'initiative de ce projet, devra donc faire preuve de sa compétence diplomatique.
Un entretien réalisé par Laurence Aubron.