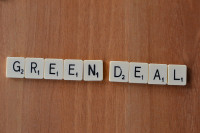Aujourd'hui en Europe est un journal consacré aux actualités européennes du jour, réalisé par la rédaction d'Euradio à Bruxelles. Avec Thomas Kox, Baptiste Maisonnave, Paul Thorineau et Ulrich Huygevelde.
Au programme :
- Mur de drone européen : Payer ou faire payer
- Parlement : Ursula von der Leyen confrontée à deux motions de censure consécutives
- UE-Maroc : Une innovation juridique pour conclure un accord
On ouvre ce journal en se penchant sur un plan de défense, celui d’un mur de drone imaginé par la Commission européenne, pour protéger ses frontières des nombreuses incursions survenues ces dernières semaines. Un projet d’ampleur, qui ne plaît pas à tout le monde.
Depuis l’annonce de cette initiative lors du discours sur l’État de l’Union, Ursula von der Leyen en défend la nécessité dans ses déplacements.Le dossier a figuré parmi les sujets majeurs du sommet informel des Vingt-Sept à Copenhague le 1ᵉʳ octobre — dans un contexte d’alerte renforcée après des survols de drones, y compris au Danemark.
Ce sont surtout les pays baltes, comme la Pologne, qui poussent pour la mise en œuvre rapide du mur. Mais au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la frontière orientale, la portée du projet suscite plus de réticences. Le président français Emmanuel Macron affirme que les drones et systèmes anti-drones sont une priorité, mais il juge l’idée d’un mur parfait « infaisable » dans sa globalité.
En Allemagne également, et malgré le survol de drones jeudi dernier entraînant la fermeture de l’espace aérien, l'eurodéputée Hannah Neumann rappelle que ce mur n’est pas une “solution facile”, et qu’il ne “protégera pas des cyberattaques, des pénuries de munitions ou de problèmes structurels plus profonds”.
D’autant que le plan a un certain prix, le Commissaire européen à la défense et à l’espace, Andrius Kubilius, chiffrait la première version du plan de protection des pays baltes à un milliard d’euros.
Bruxelles souhaite mobiliser des fonds européens, ce qui exige un accord unanime des 27 États — un obstacle majeur. L’Italie et la Grèce, entre autres, estiment que les dépenses de défense doivent profiter à l’ensemble des 27, et pas seulement à certaines zones.
Selon les informations du média Euractiv, la commission européenne recherche donc d’autres financements pour soutenir l’industrie des drones. Il y aurait par exemple l’idée d’un fond pour les drones, similaire à celui qui existe déjà pour soutenir la production de munitions, mais rien n’est conclu pour le moment.
Pourtant, depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, la technologie des drones est devenue un sujet incontournable pour les fabricants d’armes européens.
C’est le moins qu’on puisse dire, mais si quelques start ups et petites usines voient le jour, elles sont loin d’être suffisantes pour subvenir au besoin. La question de la production risque de prendre encore plusieurs mois, voire plusieurs années.
Or, comme le rappelait le secrétaire général de l’OTAN en septembre, “il n’est pas viable d’abattre des drones coûtant plusieurs milliers d’euros avec des missiles coûtant entre un demi-million et plusieurs millions d’euros”.
On continue ce journal à Strasbourg, où seront débattues cette semaine deux motions de censure à l’encontre de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Oui, à peine trois mois après la première motion de censure déposée par les groupes d’extrême droite du Parlement, qui avait rassemblé les voix de 175 des 720 députés, la présidente de la Commission se retrouve à nouveau sur le fil. Les débats ont eu lieu lundi, en fin d'après-midi ; les votes, eux, auront lieu jeudi midi. Pour rappel, la motion de censure doit réunir les deux tiers des suffrages et la majorité absolue des membres du Parlement, soit au moins 361 députés pour être adoptée. Aucune n’a jamais rencontré ces critères depuis 1999.
Cette fois-ci, les deux motions ont été déposées respectivement par le groupe des Patriotes pour l’Europe, et par La Gauche.
Et quel est l’objet de leur mécontentement ?
Dans le cas du groupe d’extrême droite, il s’agit de l’accord entre l’UE et le Mercosur. Ils craignent, entre autres, que les pays d’Amérique du Sud concernés par l’accord écrasent les agriculteurs européens. Du côté de La Gauche, les parlementaires sont vent debout contre la stratégie commerciale de la Commission, et sa position sur la guerre à Gaza, jugée insuffisante. Les deux partis s’accordent par ailleurs sur un point : ils trouvent défavorables les conditions imposées par l’accord commercial entre l’Union européenne et les Etats-Unis.
Si les autres partis ne sont pas allés jusqu’à demander une motion de censure, nombreux sont ceux qui critiquent cet engagement de l’Europe, qui inclut, entre autres, de dépenser 750 milliards d’euros en énergie américaine et 600 milliards sur leur marché.
Existe-t-il un véritable risque pour le mandat d’Ursula von der Leyen ?
A priori, non. La Présidente devrait s’en sortir grâce au soutien des trois partis centristes : le Parti populaire européen, les Socialistes et Démocrates, et Renew Europe. C’est d’ailleurs en grande partie à ces groupes qu’elle doit sa réélection.
Mais plusieurs fissures apparaissent dans le bloc pro-européen : les Verts notamment, sont de plus en plus critiques envers le mandat de Von der Leyen - ils avaient, en partie, voté pour sa destitution lors de la dernière motion de censure.
On termine ce journal en s’intéressant à un accord commercial entre l’Union européenne et le Maroc. Un accord menacé par la Cour de justice de l’UE, insatisfaite d'une clause sur le Sahara occidental.
Oui, c’était en octobre 2024. La Cour de Justice avait réfuté l’accord sur les produits agricoles et de la pêche car il manquait le consentement du peuple sahraoui, et violait donc le principe d’autodétermination. Douze mois de délai ont été accordés, et le sujet est de nouveau sur la table.
Pour l’Europe, la position est complexe : elle cherche à faire signer cet accord sans s'attirer les foudres du Maroc, qui ne reconnaît pas le peuple sahraoui. Le Sahara occidental, occupé presque exclusivement par Rabat depuis 1975, est reconnu par l’ONU comme un territoire non autonome. Mais il s’agit du dernier territoire du continent africain dont le statut post-colonial n’est pas réglé. 80% du territoire est sous contrôle marocain, à l’ouest et 20% du Sahara occidental reste sous le contrôle du front Polisario à l’Est, et entre les deux se trouve une zone tampon, gérée par les casques bleus de l’ONU.
L’Union européenne a dû trouver une solution pour passer outre cette ambiguïté territoriale, et le consentement des Sahraouis.
Oui, et la solution prend la forme… d’étiquettes. La Commission propose que les produits en provenance du Sahara occidental soient étiquetés, de manière à préciser leur origine. Une décision juridique qui n’a pas ni de précédent dans le droit commercial européen, ni dans les normes internationales.
L’accord concerne également le peuple Sahraoui, pour qui Bruxelles financera des projets dans le domaine de l’eau, de l’énergie, de la lutte contre la désertification et de l’aide humanitaire.
Un journal de Baptiste Maisonnave, Ulrich Huygevelde et Paul Thorineau.