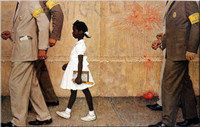Avec sa chronique Les femmes ou les "oublis" de l'Histoire, Juliette Raynaud explore "les silences de l'Histoire" (Michelle Perrot) et nous invite à (re)découvrir notre matrimoine oublié, une histoire après l'autre...
Vous connaissez Madeleine Pelletier ? Elle fut la première femme admise en médecine interne. Doctoresse engagée, elle soigna les habitants des quartiers populaires de Paris, la nuit, et pratiqua des avortements clandestins durement punis.
Education, contraception, mariage… elle rêvait de liberté et de justice. Cette grande figure du féminisme du tout début du XXe siècle lutta toute sa vie pour l’égalité, avec des prises de position féministes radicales qu’on peut considérer comme avant-gardistes (encore que, si l’on en croit Jean Cocteau, « il n’y a pas de précurseurs, il n’y a que des retardataires »…).
Paris, 1904.
Madeleine Pelletier est admise à l’internat de médecine psychiatrique. Après un long combat, elle est parvenue à s’inscrire au concours, jusqu’alors interdit aux femmes. L’étudiante de 28 ans a une ambition et une soif de justice hors du commun. Issue d’un milieu très pauvre où l’on n’envisage pas les études, elle a obtenu son bac avec mention « Très Bien » en étudiant seule. Elle le sait : plus on est instruit, plus on peut transformer la société.
Mais cette victoire, elle ne l’a pas obtenue seule : la lutte est collective. Elle présente son parcours comme une « victoire féministe » dans une interview dans le journal La Presse. Au-delà d’un exemple de femme qui s’est battue pour elle-même, elle revendique de nouveaux droits pour toutes les femmes. Un de ses chevaux de bataille est la lutte pour le droit à l’éducation sans restriction, sans différenciation de genre. Une de ses tribunes dans les Annales politiques et littéraires de 1907 témoigne de ses convictions avant-gardistes :
« Pas plus que l’homme, la femme ne doit chercher sa raison d’être en dehors d’elle-même. (…) La maternité ne sera plus qu’un épisode dans son existence comme la paternité n’est qu’un épisode dans une existence masculine. Aujourd’hui, la plupart des femmes ne sont que des épouses de leurs maris, demain, elles seront avant tout elles-mêmes. »
En 1898, Madeleine Pelletier fait partie des 129 femmes sur 4500 étudiants en médecine. Elle est bien décidée à faire évoluer la société et la médecine. Elle choisit les sciences, une carrière « masculine » parce qu’elle a compris : ce qui est codé au masculin correspond à ce qui est le plus valorisé dans la société. Elle a conscience également que dans les sciences se joue aussi un des noyaux du système de domination sexiste : l’idée que les femmes sont intellectuellement inférieures aux hommes et, en médecine, la pathologisation du corps des femmes. Tout ce qui se joue autour du corps des femmes est à la base du système de domination.
Première féministe à défendre le droit à l’avortement dans une publication de 1911, elle est persuadée qu’un des noyaux durs de l’oppression des femmes se situe dans l’intimité, dans la sexualité, dans l’appropriation du corps des femmes par les hommes. Ce discours ultra moderne n’est pas juste le reflet d’une conviction, c’est aussi le résultat de ses observations en tant que médecine et il se traduit dans des actes.
Médecin des pauvres, elle exerce la nuit dans les quartiers populaires de Paris où elle rencontre des femmes qui recourent à l’avortement malgré le danger et l’illégalité de cet acte lourdement condamné. Madeleine voit dans la maternité l’une des causes majeures de l’oppression des femmes. Elle a écrit une vingtaine de textes féministes et communistes (« Les femmes peuvent-elles avoir du génie ? », « Supérieur ! Drame des classes sociales en cinq actes », « L’émancipation sexuelle de la femme », etc.). Théoricienne et activiste, elle n’a jamais dissocié ses idées et ses actions.
Adolescente, Madeleine faisait le mur pour participer à des réunions anarchistes. Adulte, elle veut abolir le mariage et défend le droit de vote des femmes. Elle manifeste en France et à l’étranger aux côtés des Suffragettes. Militante, c’est grâce à elle que le droit de vote est intégré au programme du Parti socialiste en 1906. Elle se rend seule en Russie pour témoigner de la Révolution d’Octobre 1917.
Radicale, elle s’oppose aux féministes « en dentelle » et plaide pour une « dégenrification ». Alors qu’aujourd’hui, on refuse de plus en plus la binarité de la société, Madeleine se présentait comme un homme de son époque, au début du XXe siècle : cheveux courts, costume, chapeau et canne. Elle porte même un revolver. Ses idées sont parfois mal reçues, y compris par des communistes et des féministes qui la jugent « extrême », et son apparence masculine lui vaut bien des moqueries et des critiques acerbes mais (car ?) sa théorie de la virilisation des femmes est fondamentale.
Elle a anticipé beaucoup d’idées qui sont aujourd’hui communément admises. Elle ne le formule comme Simone de Beauvoir, mais elle fait déjà une distinction entre sexe et genre. Elle estime que le genre féminin est le produit d’une position inférieure dans la société. Elle souhaite la disparition du vestiaire féminin car elle estime qu’il représente un comportement d’esclave qui tente de séduire le maître. Pour elle, « les femmes doivent être des hommes socialement ».
En 1939, elle est arrêtée sur dénonciation pour « crime d’avortement ». Un avortement pratiqué sur une jeune fille violée par son frère. Madeleine Pelletier, 65 ans, hémiplégique après un AVC, est condamnée, non pas à la prison mais à l’asile… Ironie du destin, elle est faite passer pour folle et internée dans l’asile même où elle a suivi son internat. Elle meurt dans l’année. Enterrée dans une fosse commune, longtemps gommée de l’histoire, Madeleine Pelletier avait conscience d’être « née trop tôt ». Il faudra attendre 1944 pour que les femmes aient le droit de vote en France et 1975 pour qu’elles puissent avorter en toute légalité.
« Elle a payé tellement cher son engagement et on bénéficie tant de ses avancées. Encore aujourd’hui, elle fait polémique, car l’égalité sur tous les plans dérange encore » - Christine Bard, historienne spécialiste de l'histoire des femmes, du genre, du féminisme et de l'antiféminisme.