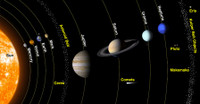Tous les mercredis, écoutez Iris Herbelot discuter d'un sujet du secteur spatial. Tantôt sujet d'actualité ou bien sujet d'histoire, découvrez les enjeux du programme européen Hermès, de la nouvelle Ariane 6, ou encore de la place de l'Europe dans le programme Artémis. Ici, nous parlons des enjeux stratégiques pour notre continent d'utiliser l'espace pour découvrir, innover, et se défendre.
Nous nous retrouvons pour un épisode consacré à la politique spatiale européenne. Nous avons déjà évoqué dans La guerre des étoiles les programmes Sentinelles de Copernic, qui observent la Terre et servent –entre autres– aux situations d’urgence pour porter secours aux blessés. Nous avions aussi consacré des épisodes à la constellation Gallilée, les satellites européens plus précis encore que le GPS américain ; et à IRIS², le projet de constellation de satellites européens pour des communications sécurisées, à destination notamment des institutions étatiques. Que faut-il rajouter à cette liste déjà très honorable ?
Il faut rajouter quelques projets de programmes qui sont portés purement par l’Union européenne, qui, il faut le rappeler, se repose sur l’ESA, mais pas l’inverse. L’agence spatiale européenne, l’ESA, dont on parle souvent, n’a rien à voir avec les vingt-sept pays de l’Union européenne, si ce n’est que la plupart en sont contributeurs.
Ceci étant dit, l’UE doit faire face, on le sait tous, à une menace sécuritaire existentielle, et investit massivement, par ses fonds propres et par le biais des Etats-membres, dans le secteur de la défense, qui est très lié au secteur spatial.
Les nouveaux horizons de la politique spatiale européenne sont donc à visée sécuritaire ?
Essentiellement, oui. Sauf que là où les achats et les productions sont relancés et renforcés dans l’urgence, les programmes spatiaux s’inscrivent dans un temps long, et les politiques adoptées pour l’instant sont un peu différentes, notamment en fonction des périodes anticipées. Par exemple, IRIS² sera probablement beaucoup utilisée pour des communications militaires lors de sa mise en service, là où ce n’était pas son objectif premier lors de sa conception. Mais c’est un programme qui arrive à une mise en œuvre après des années de préparation. Donc comme les satellites sont progressivement placés en orbite, on pourra à moyen-terme adapter leur usage. Le Commissaire à la défense et à l’espace, Andrius Kubilius, peut d’ors et déjà établir et lancer des programmes spatiaux pour répondre à des enjeux sécuritaires européens à long-terme, mais rien ne sera prêt à court terme, or, la Russie attaque déjà l’Europe.
Quelles sont les options à court terme, alors ?
C’est de faire usage de ce qui existe déjà, comme ça pourra être le cas pour IRIS². Donc ça veut dire adopter résolument la tendance à faire appel à des services et constellations commerciaux pour un usage militaire. Les Etats-Unis le font déjà et avec un volume croissant pour l’observation de la Terre et le renseignement militaire, et c’est une pratique qui s’élargit, de fait, à l’OTAN. Depuis 2019, l’OTAN considère l’espace comme un domaine opérationnel, donc susceptible d’être un théâtre d’opérations militaires, avec ou sans troupes humaines. Et depuis février 2025, l’OTAN a établi une stratégie d’intégration des capacités et des outils commerciaux des Etats parties à l’OTAN pour subvenir aux besoins sécuritaires de l’Alliance. Concrètement, ça veut dire qu’une constellation de communications commerciales germano-britannique, par exemple, devrait être mobilisable pour assurer des communications peu sensibles mais nécessaires aux Alliés si leur couverture était optimale. Autre exemple, un observatoire français utilisant des données satellitaires météorologiques devrait pouvoir fournir des données à une corvette ou un porte-avion italien rapidement dans le cadre d’une mission de l’OTAN ou européenne chapeautée –ou non– par l’OTAN, comme par exemple la mission IRINI en Méditerranée.
Si les Etats-Unis ont de plus en plus recours à des fournisseurs commerciaux, c’est une solution de court terme qui s’inscrit aussi dans des programmes de long terme.
Absolument, et ça pourrait d’ailleurs devenir un problème. Si même l’OTAN mêle commercial et militaire, cela revient à un désengagement des infrastructures militaires au profit de partenariats commerciaux avec les armées, à un moment où les conflits s’intensifient et se multiplient partout dans le monde, y compris sur le territoire européen. Or, cela rend dépendantes les capacités opérationnelles des Alliés, là où les tendances géopolitiques invitent au contraire à une reprise en main capacitaire des armées.
Quel rôle joue l’Union européenne dans tout cela ?
L’UE joue un rôle de soutien financier et va avoir un rôle croissant dans la relance du secteur industriel de la défense. Et le EU Space Act, présenté en juin 2025 par la Commission européenne, vise à assurer un environnement propice au développement et au renforcement des fournisseurs commerciaux, justement. Ça inclut un cadre responsabilisant sur les débris spatiaux en orbite, un cadre législatif commun sur la cybersécurité et les financements de R&D, par exemple. Et de par son poids économique et sa force –souvent sous-exploitée– politique, l’UE peut imposer ce cadre et ces responsabilités aux entreprises et acteurs non-Européens, par le biais de l’OTAN pour les acteurs américains et par des accords commerciaux pour la Chine, par exemple.
C’est aussi au sein de l’UE et du PEID que se développe l’Oeil d’Odin, un système de détection avancé de missiles, porté par l’Allemagne, majoritairement, et auquel participent la France, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche et la Lituanie.
Un entretien réalisé par Laurence Aubron.