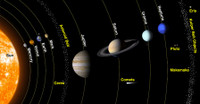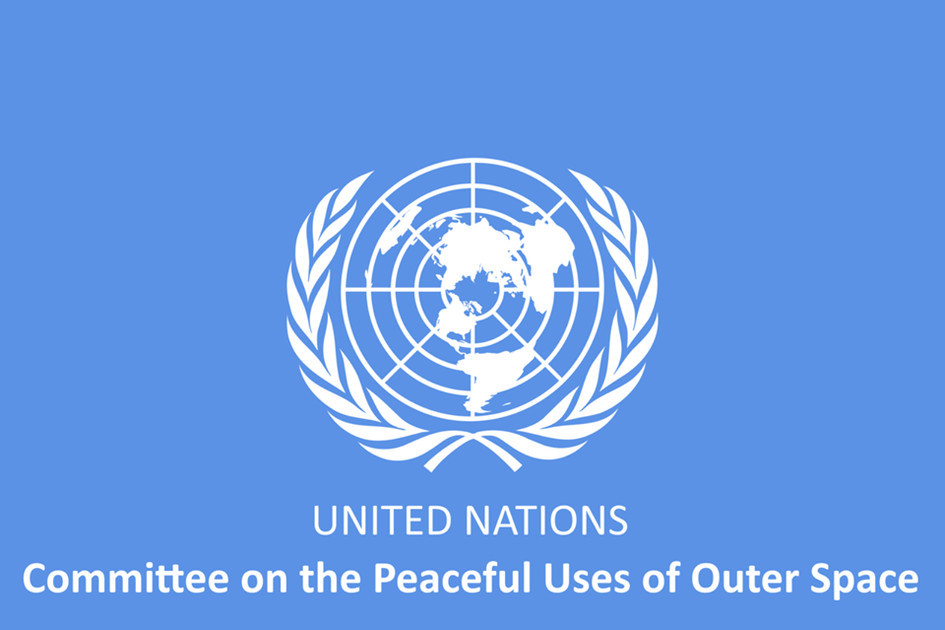
Tous les mercredis, écoutez Iris Herbelot discuter d'un sujet du secteur spatial. Tantôt sujet d'actualité ou bien sujet d'histoire, découvrez les enjeux du programme européen Hermès, de la nouvelle Ariane 6, ou encore de la place de l'Europe dans le programme Artémis. Ici, nous parlons des enjeux stratégiques pour notre continent d'utiliser l'espace pour découvrir, innover, et se défendre.
On se retrouve aujourd’hui pour parler du droit international, plus particulièrement de celui qui régit le domaine spatial. Avant même de plonger dans ce sujet, est-ce qu’on peut dire que ça semble ambitieux alors même que la majorité des pays sur Terre n’ont pas d’accès indépendant à l’espace ?
Effectivement ça ressemble bien à l’hybris humain, surtout que le traité central qui régit tout ça, celui de l’ONU, a été rédigé et adopté en 1967 ! Et à l’époque, il y avait encore moins de pays qu’aujourd’hui qui pouvaient placer des charges utiles en orbite terrestre et au-delà.
Dans quel contexte est né ce traité ?
Dans les années 60, on est en pleine guerre froide entre les Etats-Unis et l’Union soviétique, c’est les années Kennedy et Johnson, la NASA est établie depuis une bonne décennie, la course à l’espace et à l’armement bat son plein, la crise des missiles de Cuba n’est pas loin, c’est une période de grandes tensions.
Et au milieu de tout ça, on a l’ONU, un forum international où siègent à l’assemblée générale des pays du mouvement non-aligné, qui a été formalisé en 1955 ; au Conseil de Sécurité siègent les US et l’URSS, mais aussi la France de De Gaulle, qui n’est pas systématiquement aligné aux Etats-Unis, et le Royaume-Uni, allié des Américains mais qui à la fin des années 60 a bien entamé son rapprochement à la CEE et prépare son adhésion à ce qui deviendra l’Union européenne, et qui ne veut pas antagoniser De Gaulle. Et on a la Chine, avec qui les relations transpacifiques n’ont pas encore été normalisées.
Donc c’est un combo de tensions politiques, militaires, stratégiques, qui se cristallisent sur la question de la course aux armements, et surtout sur la peur intrinsèque, pour l’humanité, du risque de placer en orbite terrestre des armes de destruction massive. Et c’est dans ce contexte-là que le traité s’inscrit.
Le monde se souvenait encore bien des champignons nucléaires. Qui était à l’origine de ce traité, et comment a-t-il été accepté ?
Il a été soumis par trois membres permanents du CdS, l’URSS, les USA et le Royaume-Uni. Et il a été adopté par l’Assemblée générale en 1966, ratifié par le Sénat américain dans la foulée, entrant en vigueur en 1967. La France ne l’a ratifié que trois ans plus tard.
Sur la question de pourquoi il a été adopté, c’est la même réflexion qui a motivé les prises de contact après le début de la guerre froide en 1947 et après la crise des missiles de Cuba en 1962 : la peur des deux grands blocs de s’annihiler mutuellement. Et là où les accords SALT sur la limitation des armements n’ont pas abouti, la perspective d’armer un espace sans frontières a suffit, et à une époque où les technologies pour placer en orbite et manoeuvrer les charges utiles placées en orbite n’était pas tout à fait maîtrisées, c’était suicidaire de courir à ces risques, et très coûteux en plus.
Pourquoi passer par l’ONU ?
Parce que les institutions internationales pendant la guerre froide ont autant servi à exercer une influence sur d’autres pays, comme par le biais de l’OMS ou de l’UNESCO ; qu’à réellement communiquer par des canaux diplomatiques qui n’étaient pas bilatéraux, et donc qui subissaient moins les aléas des tensions politiques entre Etats-Unis et Union soviétique.
En plus, le Comité de l’ONU dédié à l’espace extra-atmosphérique, qui a été créé en 1959 et est basé à Vienne, donc en Europe, permettait d’apporter une médiation juridique sur un terrain plus neutre.
Que contient ce traité ?
Le traité de l’espace en lui-même, qui de son nom complet est le traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, contient 27 articles, qui couvrent des sujets étonnamment variés vu le peu de visibilité sur l’évolution technologique et politique qu’allait connaître le monde à l’époque.
L’article qui interdit de placer en orbite un objet porteur d’arme nucléaire ou tout autre arme de destruction massive est l’article 4. Les articles 1, 2 et 3 mettent l’accent sur l’aspect universel de l’accès à l’espace et sur l’objectif pacifique et devant bénéficier à l’humanité de l’exploration spatiale.
Je ne vais pas analyser tous les articles du traité maintenant, mais un article en particulier est très intéressant aujourd’hui avec l’évolution du secteur spatial, et la privatisation de l’accès à l’espace, ce qui était totalement hors de propos dans les années 60 : l’article 7 reste très pertinent, parce qu’il dispose que les Etats dont le territoire sert de point de lancement à un objet dans l’espace sont légalement responsables de cet objet.
Même quand le lanceur et l’objet sont privés.
Même quand ils sont privés, et même quand ils sont étrangers. C’est-à-dire que les Etats-Unis sont responsables du bon déroulé du lancement d’un satellite Galileo lancé sur une fusée Space X depuis Cape Canaveral, par exemple.
L’idée derrière cette clause du traité, c’était de pousser les Etats à s’assurer de la sécurité des lancements, d’éviter de prendre des risques pour les populations dans les zones de lancement, et de prendre en charge le désorbitage des objets en orbite pour ne pas qu’ils s’écrasent aléatoirement sur des zones peuplées.
Ça ne ressemble pas au genre de responsabilité que l’administration Trump voudrait confier à l’agence fédérale de l’aviation.
Effectivement, c’est par exemple en lien avec ces obligations que la FAA a longuement empêché le Starship de Space X de décoller, à la grande irritation d’Elon Musk. Et même avant, pendant le premier mandat de Donald Trump de 2017 à 2021, c’est en partie pour ça qu’ont été élaborés et plébiscités les accords Artémis, qui visent à se substituer au traité de l’espace.
Et ils sont bien pratiques ces accords, parce qu’ils dédouanent bien plus les Etats, qu’ils sont beaucoup plus favorables à une vision capitaliste et privatisée de l’exploration et de la conquête spatiale, là où l’ONU en 1967 interdisait explicitement d’occuper et de coloniser un objet céleste.
Et que cerise sur le gâteau, les accords Artémis permettent aux Etats-Unis de reprendre la main sur le droit international selon leurs termes, plutôt que de participer activement au sein d’une institution internationale qu’ils peuvent dominer mais où théoriquement ils sont au même niveau que les autres nations membres.
Un entretien réalisé par Laurence Aubron.