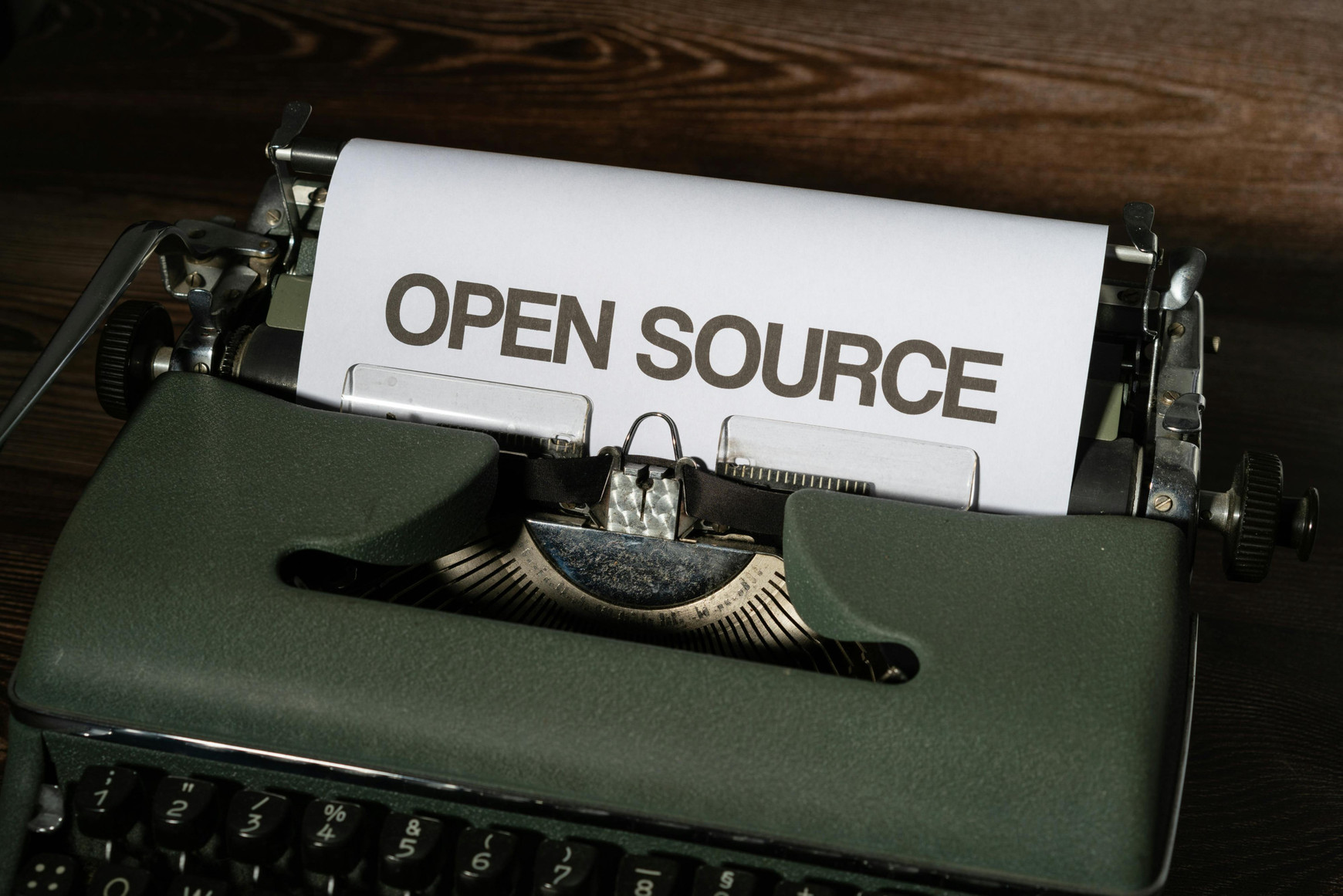
Une chronique de Christine Le Brun, Experte Smart Cities & Places chez Onepoint, où nous parlerons de villes, d’outils et de technologies numériques, de données, mais aussi des citoyens et de ceux qui font les villes.
Bonjour Christine Le Brun, après l’open data et le service public de la donnée, vous allez aujourd’hui aborder une manière dont on peut partager le numérique. Cette fois, dans le domaine des logiciels, où l’on parle d’open source.
Oui Laurence, derrière open source, il faut entendre open source code. Le code source d’un logiciel c’est un ensemble d'instructions écrites dans un langage informatique évolué, qui décrivent ce que doit faire ce logiciel. L’idée derrière l’open source est donc de partager ce code, ce programme informatique. C’est un autre aspect de la démarche de communs numériques, comme l’open data.
Et quels en sont les grands principes ?
Dans le monde de l’open source, le créateur d’un logiciel peut décider de publier le code source de son programme. C’est-à-dire qu’il le rend disponible pour une communauté de développeurs. Ainsi, n’importe qui peut le récupérer et y apporter sa contribution. Cela peut être pour l’améliorer ou apporter des corrections. C’est la force de l’intelligence collective. Mais un développeur peut aussi créer une nouvelle version de ce logiciel en le modifiant et en l’adaptant à ses propres besoins. Selon les cas, il peut ou même doit lui-même republier ensuite les résultats de ses travaux. Pour que ce système fonctionne, la notion de transparence est également très importante. Le code doit pouvoir être consulté et donc audité, notamment pour des raisons de sécurité.
Mais quel est l’intérêt pour celui qui crée le code ? D’habitude on entend plutôt parler de brevets ou de licences commerciales…
Et bien d’abord, publier son code en open source ne signifie pas que vous mettez à disposition toute la valeur. En tant que créateur, vous êtes bien placé pour monétiser des services, de l’expertise, du conseil, de la formation sur ce que vous avez initié. C’est le modèle de la société RedHat, qui anime une énorme communauté de développeurs autour du système d’exploitation Linux, avec un chiffre d’affaires qui dépasse le milliard de dollars. Vous pouvez aussi ne mettre à disposition qu’une partie du code, et proposer des développements supplémentaires qui s’appuieront dessus mais seront alors spécifiques à chacun de vos clients.
Et donc, dans le domaine de la ville intelligente on s’intéresse particulièrement à cette démarche ? Pourquoi ?
Il y principalement 2 raisons à cela. La première est que quand vous achetez un logiciel, disons, classique, vous achetez en réalité une simple licence de ce logiciel. Sa qualité, sa pérennité et son modèle économique de distribution dépendent uniquement de l’éditeur, qui peut en changer à tout moment, vous imposer des mises à jour payantes, changer de stratégie, ou même disparaitre en vous laissant en plan avec un produit obsolète. De nombreuses collectivités sont de plus en plus méfiantes vis-à-vis de ces éditeurs, parce qu’ils ont parfois des pratiques commerciales agressives qui visent à garder leurs clients captifs avec des retours en arrière très difficiles, et couteux. Elles cherchent donc à limiter leur dépendance. Et dans le contexte international tendu actuellement avec les Etats Unis, cela devient même un enjeu de souveraineté numérique qui est regardé de très près.
Et donc l’open source est une piste ?
Tout à fait. Si vous imposez à vos fournisseurs de travailler sur des bases Open Source, cela veut dire que le code est public et que votre fournisseur est dans ce cas plutôt un prestataire de services. Si ce dernier ne vous convient plus, vous pouvez en changer tout en continuant à travailler sur le même code. Mais ce n’est pas tout.
Oui, vous nous aviez parlé d’une 2e raison pour laquelle les collectivités s’intéressent à l’open source.
En effet, il y a un vrai intérêt à travailler de manière communautaire. Même si les collectivités sont bien sur différentes les unes des autres, elles ont souvent des problématiques sinon identiques, du moins très proches. Dans le domaine des villes intelligentes, on parle beaucoup de cas d’usage, qui correspondent peu ou prou à des besoins métier, comme l’éclairage, les déchets, ou la videoprotection. Vous vous souvenez que je vous avais parlé des hyperviseurs, ces systèmes qui concentrent les données issues de plusieurs domaines pour donner une vision à 360° de ce qui se passe dans la ville. Alors par exemple, imaginons que vous êtes une ville qui développe ou fait développer un hyperviseur pour l’éclairage et les caméras. Si tout est en open source, vous allez le mettre à la disposition d’autres collectivités, qui ainsi iront plus vite, et pour moins cher.
Mais quel est l’intérêt alors, pour cette collectivité, qui paye pour les autres ?
Et bien, les autres auront peut-être développé, de leur côté, d’autres cas d’usages sur l’arrosage ou la qualité de l’air, dont elle va pouvoir bénéficier à son tour. Ainsi, petit à petit, on crée une communauté et une vraie solution qui répond aux enjeux de souveraineté propres aux collectivités. Et surtout au passage, on mutualise les efforts budgétaires, dans un contexte extrêmement contraint. Encore de l’intelligence à plusieurs !
Un entretien réalisé par Laurence Aubron.






