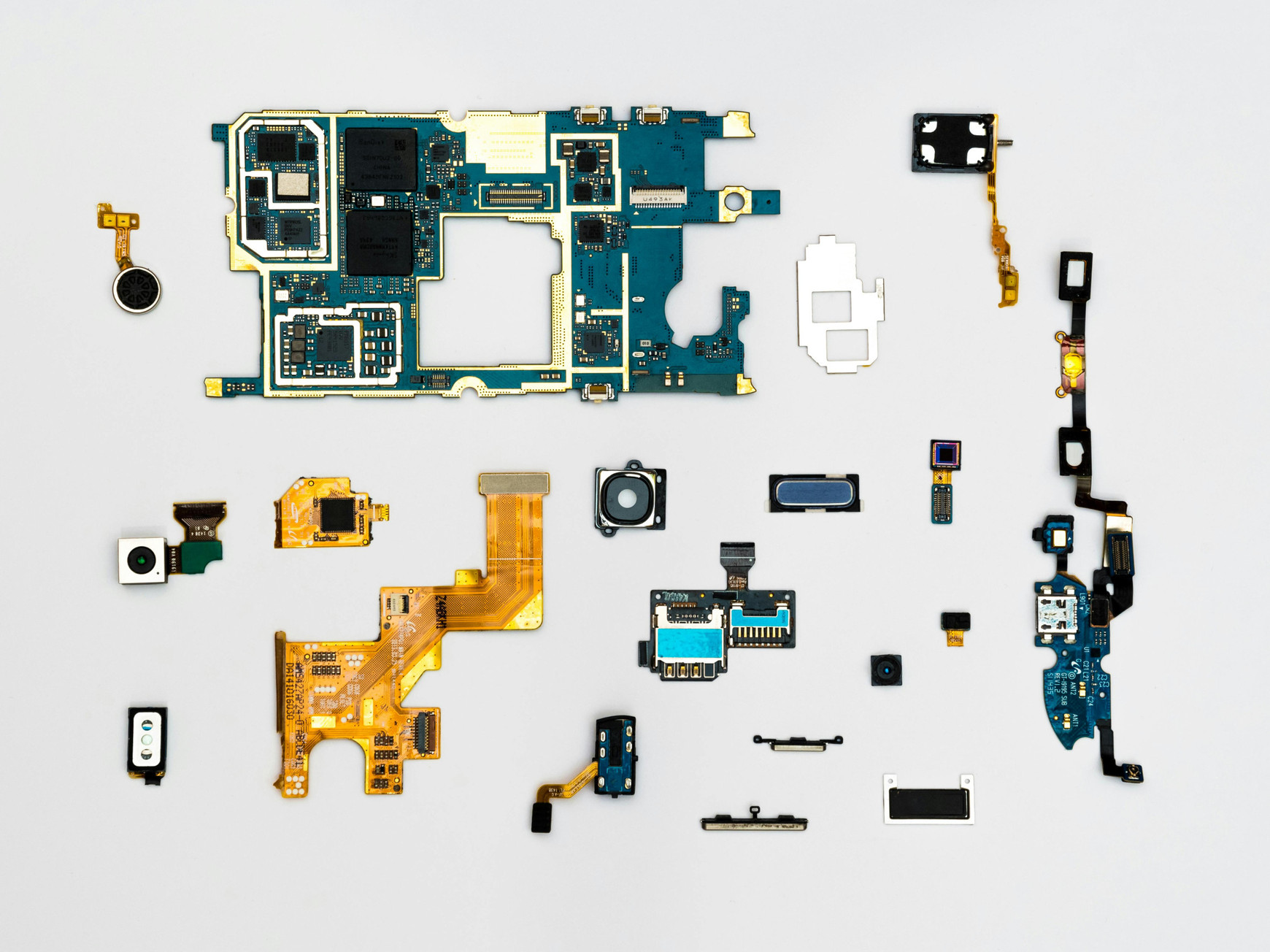
Euronomics sur euradio est une émission du Centre de Politique Européenne, think-tank spécialisé dans l’étude des problématiques réglementaires, économiques et technologiques européennes, dont Victor Warhem, économiste de formation, est le représentant en France.
Bonjour Victor Wahrem, aujourd’hui, vous allez de nouveau nous parler de technologie.
Oui Laurence, j’aimerais aujourd’hui, après avoir évoqué les “gaps technologiques” que la Commission met en avant dans le Livre Blanc sur l’avenir de la défense la semaine dernière, parler de la place qu’occupe l’Europe dans la compétition aux technologies critiques d’après l’Australian Strategic Policy Institute, le bien nommé ASPI, un think-tank australien qui a développé un “Critical Technology Tracker” qui permet de mesurer la recherche critique à fort impact – celle d’excellente qualité qui va aboutir à des technologies critiques - à l’échelle des établissements de recherche et des pays.
Très bien, mais avant toute chose, qu’est-ce qu’une technologie critique ?
La notion de “technologie critique” apparait dans le jargon de l’administration américaine dans les années 1990 pour désigner ce que les Français et Européens nomment généralement les technologies-clés : celles qui permettent d’atteindre les objectifs stratégiques d’un pays donné. Compte tenu du contexte, ces objectifs sont aujourd’hui en Europe selon la Commission : autonomie stratégique renforcée, souveraineté technologique complète, sécurité européenne plus solide, et enfin transition écologique accélérée.
Et pour l’ASPI, qu’est-ce qu’une technologie critique ?
L’ASPI se base sur la liste de technologies critiques du gouvernement australien, qui est semble-t-il le fruit d’un travail concerté avec d’autres gouvernements.
Avec la deuxième version du Tracker sortie en 2024, l’ASPI met en avant 64 technologies critiques différentes dans dix domaines dont neuf qui nous concernent : les technologies d’information et de communication avancées, l’industrie manufacturière et les matériaux de nouvelle génération, les technologies d’IA, les biotechs, technologies génétiques et vaccins, la défense et l’espace incluant la robotique et le transport, l’énergie et l’environnement, le quantique, et enfin la détection spatiale et temporelle ainsi que la navigation.
Et donc comment se situe l’Europe sur toutes ces technologies, Victor Warhem ?
C’est là que ça se gâte : pris séparément, les Etats européens ne mènent dans aucun domaine en matière de recherche scientifique d’excellence. Ceux qui tirent leur épingle du jeu dans les Top 5 des pays en pointe sont le Royaume-Uni (36 domaines), l’Allemagne (27), l’Italie (15) tandis que la France est scientifiquement très loin derrière avec uniquement 3 domaines dans lesquels elle apparaît dans les Top 5, en raison notamment d’un puissant “brain drain” de ses talents aux Etats Unis. À titre de comparaison, la Chine est première dans 57 secteurs, et les Etats Unis premiers dans les 7 restants - tout en étant second dans les autres. En tout, une quinzaine de pays arrivent significativement à se placer dans les top 5 de l’ASPI, y compris l’Inde ou, plus étonnamment, l’Iran. Bref, face à l’émergence scientifique du Sud global, la fragmentation européenne est d’autant plus problématique.
Et que se passerait-il si l’Europe s’unissait ?
En se fondant sur les travaux de l’ASPI, elle serait déjà première dans deux domaines : les senseurs de force gravitationnelle et les petits satellites. Elle serait deuxième ou troisième dans la plupart des autres catégories. Bref, elle participerait pleinement à la compétition technologique internationale, ce qui, à n’en pas douter, est indispensable pour assurer à la fois sa souveraineté et sa prospérité.
Ah oui, il semble donc évident qu’il faille faire quelque chose pour que cela se produise. Mais quoi ?
Les solutions sont à bâtir ensemble, mais les pistes sont déjà claires.
Tout d’abord, en matière scientifique, une structure de coordination centralisée au niveau européen permettrait dans un premier temps d’aiguiller les fleurons nationaux comme le CNRS, le CEA, l’INRIA en France, ou les Max Planck et Fraunhofer Institutes en Allemagne, avec un agenda stratégique, préfigurant peut-être d’une nouvelle agence de “souveraineté technologique” européenne capable de définir et - il est permis de rêver - d’exécuter grâce aux ressources du successeur d’”Horizons Europe” par exemple, ce même agenda stratégique. C’est exactement ce que fait l’académie chinoise des sciences, structure de recherche la plus performante du monde, dotée d’un budget de 20 milliards de dollar en 2023 et menant dans 31 des 64 domaines critiques identifiés par l’ASPI.
Piste étonnante ! Mais j’imagine que les États Unis sont également une source d’inspiration.
Absolument. Car pour prototyper tout cela, il faudra une autre agence européenne indépendante pour l’innovation de rupture, s’inspirant dans la méthode bien sûr des agences américaines, les ARPAs. Et pour incuber les innovation critiques, rien ne remplacera une commande publique stable de long-terme, ce que fournit par exemple le DoD américain, le Department of Defense.
C’est tout Victor Warhem ?
On peut aussi imaginer un système à la “Little Giants chinois” de soutien global aux jeunes pousses technologiques associant grandes entreprises, secteur financier, gouvernement, ménages et établissements scientifiques pour fournir les conditions adéquates à leur succès mondial.
Une fois ce système mis en place, il faudra surveiller un indicateur clé pour mesurer son succès : si le “brain drain” s’inverse et que les talents affluent en masse, l’Europe aura gagné son pari. Donc pour inverser la tendance et gagner la course scientifique, il faudra aussi vouloir gagner la course commerciale.
Quand on voit la situation actuelle, il reste beaucoup de travail !
C’est vrai mais l’Union européenne n’a plus vraiment le choix si elle veut préserver ses démocraties et sa liberté. Les Européens finiront de s’en convaincre mais plus que jamais, le temps presse. Nous avons les cartes en main, jouons-les, ensemble !
Un entretien réalisé par Laurence Aubron.






