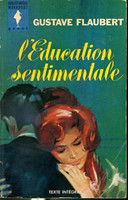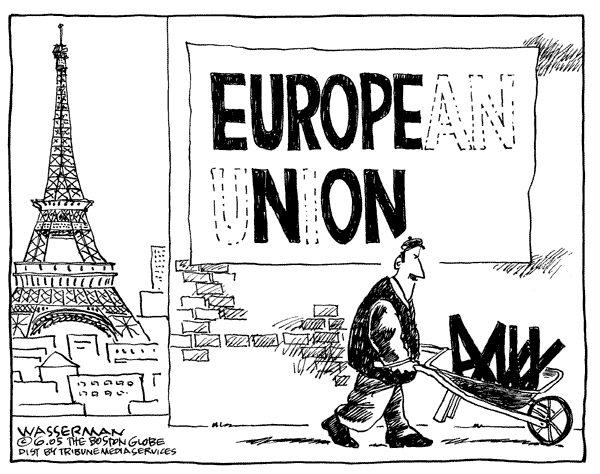
Comme chaque semaine, nous retrouvons Albrecht Sonntag, professeur à l’ESSCA Ecole de Management, à Angers.
Déjà le cinquième édito de confinement ! La semaine dernière, vous nous parliez de la visite, il y a quinze ans, en avril 2005, de Valéry Giscard d’Estaing dans votre école.
Une visite que j’ai qualifiée de « service après-vente », puisque l’ancien Président de la République était venu défendre le texte du « traité constitutionnel » qui allait être soumis au référendum le 29 mai prochain. Référendum dont le résultat est bien connu – un « Non » exprimé par 55% des votes – et qui peut être considéré aujourd’hui, avec la distance critique de quinze années, comme un moment charnière de la construction européenne. A moins que ce ne soit le début de la « dé-construction » ?
En tout cas, il a laissé de nombreuses traces. Comme beaucoup de référendums, celui-là n’a pas servi à régler une question de manière claire et acceptable pour tous, mais plutôt à dévoiler la profondeur des clivages existants, en les creusant davantage.
Il est peut-être utile de rappeler que ce texte n’apportait, en fin de compte, guère d’éléments nouveaux dans la manière dont l’intégration européenne se poursuivait, tiraillée entre la méthode communautaire à visée supranationale chère à Jean Monnet et les prérogatives des Etats-membres, jalousement défendues et célébrées par les dirigeants comme autant de victoires – sans qu’on sache contre qui au juste.
A part quelques éléments symboliques sans réelle valeur ajoutée, ce traité n’allait rien changer. L’Euro circulait déjà depuis plus de trois ans, le marché unique était devenu une réalité, et l’élargissement de 2004, avec dix nouveaux membres, n’avait pas non plus attendu la ratification d’un texte tellement vidé de substance que tous les gouvernements l’avaient signé sans problème.
Mais le traité était, de manière pompeuse et trompeuse, appelé une « constitution », un mot à connotation solennelle qui, dans ce cas précis, s’approchait de la publicité mensongère et faisait miroiter une importance dont, objectivement, il était dépourvu.
Et paradoxalement, cela a fait monter les enchères. C’est le vide relatif de ce texte qui a transformé le référendum en tribunal du bilan d’un demi-siècle de construction européenne. Plus la campagne durait, plus les chefs d’accusation pleuvaient. Tentative d’assassinat contre la souveraineté nationale. Association de malfaiteurs contre le modèle social français. Escroquerie en bande organisée par une élite contre le peuple. La défense pro-européenne, faible et peu audible, ne croyait qu’à moitié à l’innocence de l’accusé. Du coup, elle était tout sauf convaincante, noyée par l’accusation dans des détails, souvent sortis du contexte et hautement anxiogènes.
En quelque sorte, c’était la cour d’appel du procès de Maastricht, jugé par référendum en septembre 1992. A l’époque, la défense l’avait emporté, de justesse, avec 51% des votes. Les soupçons avaient été les mêmes, notamment à l’égard du projet d’union monétaire, avec en prime une grande méfiance envers une Allemagne tout d’un coup devenue trop grande.
Si les arguments de la défense avaient prévalu à ce moment-là, c’est qu’en 1992, l’accusation, malgré des procureurs du talent de Philippe Séguin, ne disposait pas encore de la référence à ce qu’on allait bientôt appeler « la mondialisation », le néologisme dominant des années 1990.
Comme l’ont montré de nombreuses études, les clivages profonds qui traversent la société française au sujet de l’intégration européenne, révélés au grand jour par le débat autour du Traité de Maastricht et ravivés de manière spectaculaire par la fausse « constitution » de 2005, sont restés étonnamment stables dans le temps.
Certes, il est aisé de démontrer que le « Non » des Français en 2005 avait de multiples causes – on peut renvoyer par exemple à la remarquable analyse publiée par la Fondation Jean Jaurès et intitulée « Le jour où la France a dit Non ». Il n’en reste pas moins pour autant que l’Europe est une thématique qui semble cristalliser des attitudes opposées envers le rouleau-compresseur du processus de la mondialisation et son carburant, le capitalisme. Elle met à nu les frustrations que ce dernier suscite en permanence. En est-elle une victime collatérale ou au contraire une complice coresponsable ?
En rétrospective, la cour d'assises -pardon, le référendum- n'a pas vraiment tranché. Il a surtout produit de l’amertume. Même du côté des vainqueurs du jour qui ont dû constater que leur vote n’a provoqué aucune révolution dans l’Union européenne, que ce soit dans ses politiques, toujours axées prioritairement sur le plus petit dénominateur commun, le marché unique, ou dans son fonctionnement, ce dont témoigne le Traité de Lisbonne, en vigueur depuis 2011. Il y a eu ce qu’on appelait une « période de réflexion », puis quelques petites touches cosmétiques, mais pas du tout le changement de cap espéré.
Mais ce que la campagne de 2005 a incontestablement révélé, c’est la fin définitive d’une période que les études européennes appellent celle du « consensus permissif » et qui couvre les quatre décennies de l’après-guerre, marquées par une confiance et une certaine « permission » accordées par les citoyens aux élites politiques pour ce qui relevait de la construction européenne. Depuis la fin du XXème siècle, cette « permission » est caduque. Les enjeux de la politique européenne ont été politisés, la confiance s’est volatilisée, la polarisation s’est consolidée.
Et vous-même, comment avez-vous vécu ce référendum ?
Je ne faisais pas d’édito sur Euradio à l’époque, dommage ! Cela m’aurait permis de vous dire à l’antenne tout ce que je pense de l’outil de démocratie directe qu’est le référendum. Un procédé qui paraît très séduisant, tellement démocratique, à première vue, mais qui a beaucoup de vices cachés.