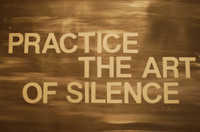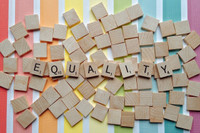Chaque mois Alain Anquetil, professeur émérite de philosophie morale à l’ESSCA, École de Management, nous livre une chronique de philosophie pratique.
Nous accueillons chaque mois Alain Anquetil, professeur émérite de philosophie morale à l’ESSCA Ecole de Management, pour une chronique de philosophie pratique. Bonjour !
Aujourd’hui, vous allez nous parler des inégalités et des projets de taxation des ultra-riches, qui font l’objet de débats à l’Assemblée nationale, en vous référant à Jean-Jacques Rousseau.
Oui, à travers ce qui en a été dit dans les médias.
Dans un article récent, l’écrivaine Lola Lafon s’est intéressée à un slogan inspiré, semble-t-il, de Rousseau : « Mangeons les riches, sinon ce sont eux qui nous mangeront » (1). Cette métaphore désignerait l’ultime option restant disponible pour supprimer les inégalités, dès lors qu’on ne parviendrait pas à taxer les personnes fortunées ou que celles-ci ne se conduiraient pas de façon éthique. Malheureusement, Lafon observe que les riches appartiennent à « une classe sociale dont la voracité obscène et décomplexée, ces temps-ci, donne la nausée ».
Relance – C’est un propos plutôt direct…
Mais Rousseau n’avait pas des mots moins durs. La citation qui suit se réfère à une époque de l’histoire humaine où l’« état de nature » (2) avait été remplacé par un premier « état civil », c’est-à-dire par une société, dans laquelle chacun éprouvait « le désir caché de faire son profit aux dépens d’autrui » (3) :
« Les riches […] ne songèrent qu’à subjuguer et asservir leurs voisins ; semblables à ces loups affamés qui ayant une fois goûté de la chair humaine rebutent toute autre nourriture et ne veulent plus que dévorer des hommes. » (4)
On retrouve la métaphore alimentaire…
Deux autres appels récents à Rousseau sont moins spectaculaires.
Favorable à une « réduction significative » et « audacieuse » des inégalités (en prônant par exemple « un écart maximal entre les revenus comme entre les fortunes allant de 1 à 10 »), le professeur de science politique Philippe Corcuff cite la dernière phrase du Discours sur l’origine de l’inégalité :
« Il est manifestement contre la loi de nature […] qu’une poignée de gens regorge de superfluités, tandis que la multitude affamée manque du nécessaire ». (5)
De l’autre côté de l’échiquier politique, c’est au commencement du Discours, dans sa dédicace, que la journaliste Eugénie Bastié retient un passage où Rousseau parle de « l’égalité que la nature a mise entre les hommes » et de « l’inégalité qu’ils ont instituée » (6). Elle se demande si l’on peut « y remédier sans causer plus de tort que de bien », et si « la diminution de la richesse des riches entraîne […] forcément une augmentation de la richesse des pauvres ».
Rousseau semble être rangé dans le camp progressiste…
En tout cas il est associé à l’idée d’égalité. Dans un document officiel de l’Union européenne, on lit que « l’écrivain Jean-Jacques Rousseau a affirmé que tous les êtres humains étaient égaux » (7).
On pourrait généraliser ce propos au XVIIIème siècle, le siècle des Lumières. Comme le dit le sociologue Jan Spurk, « les inégalités croissantes que beaucoup de journalistes et de sociologues montrent et dénoncent, se réfèrent, implicitement ou explicitement, à une idée noble héritée des Lumières : les hommes sont a priori égaux ; les conditions sociales, culturelles, politiques et économiques font que l’inégalité s’installe » (8).
Le nom de Rousseau est associé à la dénonciation des inégalités…
Et il montrait lui-même à quel point, dans la société civile, elles prennent de multiples formes. On sait aujourd’hui que « la liste des inégalités est inépuisable » et que la question des inégalités « revient de façon presque obsédante » dans les travaux de recherche en sciences sociales (9).
Mais, en France, la redistribution des richesses réduit les inégalités…
Ce qui correspond à la philosophie de l’État-providence, et même à une certaine philosophie libérale, qui repose non pas sur l’égalité, mais sur l’équité, et accepte l’existence de formes d’inégalités – des inégalités perçues comme justes. Le sociologue Raymond Boudon l’exprimait clairement :
« Les libéraux souhaitent que les règles du jeu social soient aussi équitables que possible. […] Dans l’idéal, ils acceptent les inégalités, mais […] ils souhaiteraient que celles-ci soient justifiées : qu’elles s’établissent à un niveau tel que, si l’on prétendait les atténuer au-delà de ce niveau, tous en pâtiraient, en premier lieu les plus faibles. » (10)
Le point important, comme le souligne un autre sociologue, François Dubet, est « moins de savoir quelles sont les inégalités et de les condamner comme telles, que de savoir lesquelles peuvent être tenues pour justes et lesquelles sont inacceptables et au nom de quels principes » (11).
Mais on pourrait ici encore invoquer un propos critique de Rousseau.
Sur la différence entre inégalités justes et injustes ?
Je pense plutôt à un passage dans lequel Rousseau imagine l’argument spécieux inventé par les riches au commencement de la société civile. Soucieux de conserver leurs privilèges, ils finissent par proposer l’arrangement suivant au reste de la société :
« Unissons-nous […] pour garantir de l’oppression les faibles, contenir les ambitieux, et assurer à chacun la possession de ce qui lui appartient. Instituons des règlements de justice et de paix auxquels tous soient obligés de se conformer, qui ne fassent acception de personne, et qui réparent en quelque sorte les caprices de la fortune en soumettant également le puissant et le faible à des devoirs mutuels. […] Au lieu de tourner nos forces contre nous-mêmes, rassemblons-les en un pouvoir suprême qui nous gouverne selon de sages lois. » (12)
Mais ces « règlements de justice et de paix » sont proposés par les riches pour leur seul avantage.
Rousseau semblait pessimiste…
Il aura toutefois une position plus optimiste dans Du contrat social. Il y rejette l’égalitarisme (l’égalité absolue), mais y défend une organisation sociale dans laquelle les riches ne peuvent imposer leur pouvoir aux pauvres :
« Quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. » (13)
Les circonstances politiques et sociales jouent un rôle essentiel dans la perception des inégalités (certaines inégalités criantes, qui étaient acceptées par le passé, seraient aujourd’hui intolérables), et dans les mesures prises pour les réduire. Mais si l’on pense que, à un certain moment, des décisions radicales sont nécessaires, et si, à ce moment-là, le désir d’égalité surpasse le désir de liberté, il faut surtout veiller à maintenir un équilibre entre ces deux valeurs. Elles sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement de la vie démocratique.
Un entretien réalisé par Laurence Aubron.
Références
Sur un sujet voisin, on pourra consulter la chronique philo du 4 mai 2021 : « Qu’aurait pensé Adam Smith de la politique fiscale de Joe Biden ? ».
(1) L. Lafon, « Mangeons les riches ? », Libération, 13 septembre 2025. Sur les « ultra-riches », cf. « Les seuils de l’ultra-richesse », Observatoire des inégalités, 23 janvier 2025.
(2) Dans cet état de nature, qui précède l’état civil, « l’homme est naturellement bon […] ; qu’est-ce donc qui peut l’avoir dépravé à ce point sinon les changements survenus dans sa constitution, les progrès qu’il a faits et les connaissances qu’il a acquises ? Qu’on admire tant qu’on voudra la société humaine, il n’en sera pas moins vrai qu’elle porte nécessairement les hommes à s’entre-haïr à proportion que leurs intérêts se croisent, à se rendre mutuellement des services apparents et à se faire en effet tous les maux imaginables. » (Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755, Garnier-Flammarion, 1971.)
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) P. Corcuff, « ’Alien : Earth’, la série qui pense la richesse plus finement que Ruffin et Mélenchon », Le Nouvel Obs, 1er octobre 2025.
(6) E. Bastié, « Quand l’obsession des inégalités produit de l’injustice », Le Figaro, 5 février 2025.
(7) Commission européenne, A la découverte de l’Europe, 2012.
(8) J. Spurk, « L’inégalité : le scandale de la normalité ? », SociologieS, Débats, 2011.
(9) Ibid., et J.-H. Lorenzi & A. Villemeur, La Grande Rupture. Réconcilier Keynes et Schumpeter, Odile Jacob, 2021.
(10) R. Boudon, Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le libéralisme, Odile Jacob, 2004.
(11) F. Dubet, L'expérience sociologique, La Découverte, Repères, 2017.
(12) Discours sur l’origine de l’inégalité, op. cit.
(13) Du contrat social ou Principes du droit politique, 1762, Garnier-Flammarion, 1992. Comme le rappelle le philosophe Stanley Moore, « par égalité, [Rousseau] n’entend pas l’égalité absolue, c’est-à-dire la même quantité de pouvoir et de richesses pour tous, mais l’égalité, définie comme l’absence de certaines formes d’inégalité. » (S. Moore, « Rousseau on alienation and the rights of man », History of Political Thought, 12(1), 1991, p. 73-85.)