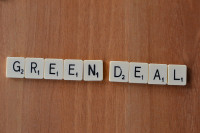Aujourd'hui en Europe est un journal consacré aux actualités européennes du jour, réalisé par la rédaction d'Euradio à Bruxelles. Avec Thomas Kox, Baptiste Maisonnave, Paul Thorineau et Ulrich Huygevelde.
Au programme :
- Pacte Migration et Asile : début du cycle, source de tension entre les 27
- L’UE envisage de créer son propre système de renseignement d’après le Financial Times + “bouclier de la démocratie”, nouveaux outils contre la désinformation
- Grace et transfert de Boualem Sansal en Allemagne
On commence ce journal à Bruxelles, où la Commission européenne a présenté mercredi une nouvelle stratégie de lutte contre la désinformation et les interférences de pays tiers. Un programme intitulé “bouclier de la démocratie”.
Oui, un titre aux accents peut être un peu pompeux, qui désigne une stratégie visant à contrer la manipulation et à éduquer les citoyens européens aux enjeux numériques et liés à l’IA. Pour rappel, plusieurs élections au sein de pays membres ou dans des États candidats à l’adhésion à l’UE ont été sévèrement impactés par la désinformation ces derniers mois - atteignant des cas extrêmes comme aux présidentielles roumaines de 2024, que la Cour constitutionnelle avait dû annuler tellement l’influence russe y était grande.
Et concrètement, comment se traduit cette stratégie ?
Et bien la Commission a présenté et proposé une série de nouveaux outils, que pourront développer les Etats membres de façon volontaire. Le plus important prend la forme d’un “Centre européen pour la résilience démocratique”, qui doit, je cite, “accroître notre capacité collective à anticiper les menaces, les détecter et y réagir”.
C’est le commissaire à la Justice, Michael McGrath, qui en prendra la tête. Il rappelait hier que les 27 bénéficient déjà du Service européen pour l’action extérieure - un système qui alerte les Etats membres en cas de menace hybride. Cette nouvelle version permettra de relier les services et les réseaux de fact-checking, y compris - nouveauté - du côté des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne.
La lutte contre la désinformation, Baptiste, est au coeur de ce programme.
Oui, avec notamment le projet de réseau européen indépendant de vérificateurs de faits, dans toutes les langues, pour lutter contre les fausses informations diffusées par la Russie dans les médias européens et en ligne. La commission a aussi annoncé vouloir renforcer son soutien au journalisme local et indépendant dans le cadre d’un programme pour la résilience des médias, qui partage également l’objectif d’une information vérifiée..
Mais ces nouvelles initiatives, rappelons-le, s’inscrivent dans un cadre de volontariat, et très peu de précisions ont été données sur la manière de les financer.
Ce n’est pas le seul projet de l’UE pour lutter contre les ingérences et les tentatives de manipulation : le journal Financial Times a révélé mardi que la Commission travaillait, très discrètement, à l’élaboration de son propre service de renseignement.
Oui, un service qui serait placé sous l’autorité directe d’Ursula von der Leyen, et rattaché au secrétariat général de la Commission. Mais le projet est loin d’être abouti, il n’a même pas encore été présenté officiellement aux 27, et difficile de savoir si les Etats membres seraient prêt à mettre en commun leurs informations en matière renseignement.
Le projet fait écho au “bouclier de la démocratie”, puisque l’Europe cherche à mutualiser ses connaissances pour anticiper au mieux les menaces hybrides. Il viendrait renforcer la partie multilatérale du SITCEN, le centre de situation et du renseignement de l’UE, qui existe déjà depuis 1999.
On continue ce journal en s’intéressant au Pacte sur la migration et l’asile dans l’UE, dont le premier rapport, publié par la Commission mardi, révèle des fissures avant même son entrée en vigueur.
Oui, principalement en ce qui concerne le financement du mécanisme de solidarité - cet outil qui détermine la participation de ces différents pays membres en cas de pression migratoire importante sur certains Etats. Le pacte donne trois options aux 27 pour gérer les demandeurs d’asile : les accueillir, financer leur relocalisation ailleurs, moyennant une contribution avoisinant les 20 000 euros par tête, ou fournir à leur pays d’accueil une autre forme de soutien, matériel principalement.
Le pacte doit entrer en vigueur en juin 2026, avec un objectif clair : répartir les flux migratoires entre les pays de l’UE, et permettre aux Etats en première ligne de relocaliser jusqu’à 30 000 demandeurs d’asile par an.
Et comment se répartissent les flux migratoires en Europe ?
Selon le rapport de la Commission, les pays actuellement soumis à une pression migratoire particulièrement forte sont la Grèce, Chypre, l’Espagne et l’Italie. Ils seront les principales cibles du mécanisme de solidarité.
Une deuxième catégorie concerne les pays dits “à risque”, soit la France, l’Allemagne, la Belgique, la Croatie, la Pologne et la Finlande. Eux pourront profiter d’un accès prioritaire à l’aide opérationnelle et financière, mais ne seront pas exemptés de contribution.
Un troisième groupe, enfin, composé de pays comme l’Autriche, la Bulgarie ou la République tchèque, est qualifié de “pays en situation migratoire significative”. Ils pourront simplement demander des déduction sur leurs contributions.
Et cette classification est une source de tensions.
Oui, depuis plusieurs mois, de nombreux pays comme l’Allemagne et la Pologne insistent auprès de la Commission pour être reconnus comme étant “sous pression migratoire” pour, d’une part, bénéficier de l’aide de leurs voisins, et de l’autre, ne pas avoir à en fournir à d’autres. Magnus Brunner a tenté de les rassurer, conscient du fait que chaque pays assure ne pas pouvoir aider davantage, en rappelant que “tous les Etats membres bénéficieront, à termes, d’aides financières ou techniques” et qu’aucun “ne sera laissé seul”.
Depuis le début de l’année 133 600 personnes sont entrées irrégulièrement sur le territoire de l’UE d’après l’agence de gestion des frontières, Frontex.
Et on termine ce journal en Allemagne, où vient d’arriver l’écrivain algérien Boualem Sansal. Après d’intenses négociations, Alger a finalement accepté la demande de gracier l’écrivain et de le transférer dans le pays pour qu’il puisse y être soigné.
Oui Boualem Sansal était emprisonné depuis presque un an en Algérie, depuis le 16 novembre 2024, officiellement pour avoir “porté atteinte à l’unité nationale”, en déclarant que l’Algérie avait hérité de territoires marocains pendant la colonisation française. Son arrestation avait suscité une forte émotion, notamment en France, et une mobilisation du milieu littéraire et politique pour demander sa libération.
Cette détention a encore un peu plus tendu des relations diplomatiques déjà au plus bas entre la France et l’Algérie. Les deux pays ont, au cours des derniers mois, expulsé des fonctionnaires, rappelé leurs ambassadeurs et ont limité les déplacements des porteurs de visas diplomatiques. Il a donc fallu faire appel à un tiers, l’Allemagne, pour mener les négociations sur ce sujet en sortant du très difficile tête-à-tête franco-algérien. Boualem Sensal est arrivé à Berlin hier, accompagné de sa femme, pour bénéficier de soins urgents liés au traitement de son cancer.
Un journal de Baptiste Maisonnave, Ulrich Huygevelde et Paul Thorineau.