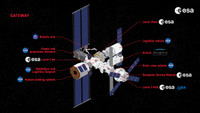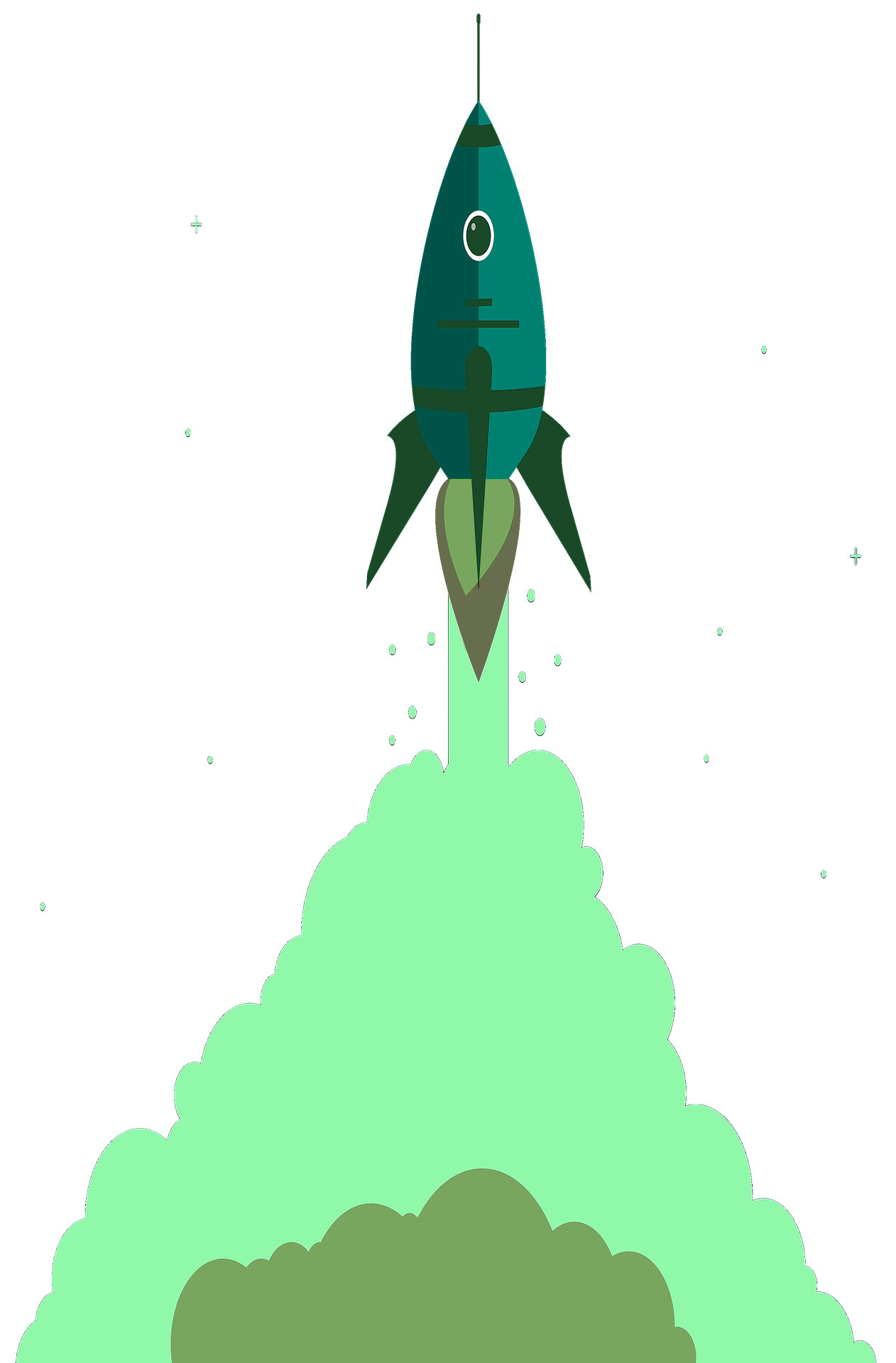
Tous les mercredis, écoutez Iris Herbelot discuter d'un sujet du secteur spatial. Tantôt sujet d'actualité ou bien sujet d'histoire, découvrez les enjeux du programme européen Hermès, de la nouvelle Ariane 6, ou encore de la place de l'Europe dans le programme Artémis. Ici, nous parlons des enjeux stratégiques pour notre continent d'utiliser l'espace pour découvrir, innover, et se défendre.
Nous avons célébré hier le Jour de la Terre, chaque année le 22 avril. Pour fêter ça, et si nous parlions de l’impact environnemental du secteur spatial ?
Avec plaisir ! Vous vous en doutez sans doute, mais la proximité du secteur spatial avec le secteur aéronautique fait que c’est une industrie extrêmement polluante, même si contrairement à l’aviation, il y a plein d’options différentes qui permettent de grandement varier le coût environnemental du secteur.
C’est-à-dire ?
Il n’y a pas vingt-cinq manières de faire un avion. Il faut des moteurs, placés sous les ailes, il faut des ailes pour la stabilité, avec des ailerons, il faut une forme spécifique pour la pénétration de l’air, et il faut stocker du carburant dans des réservoirs.
Pour une fusée, il y a un cahier des charges assez similaire parce qu’il faut un aérodynamisme, donc une fusée à bout pointu, en longueur, il faut qu’elle résiste aux températures élevées dûes à la friction dans l’air, surtout que pour s’arracher de la gravité terrestre, il faut aller vite, et donc pour faire décoller toute cette structure et ce qu’elle contient du sol, il faut aussi du carburant. Mais c’est là que s'arrêtent les similitudes. Parce que les fusées peuvent être faites avec des alliages différents, et alimentées par des carburants différents. Et que contrairement aux avions, il n’y a pas nécessairement d’humain à bord, ni même pour piloter, donc les isolations n’ont pas besoin d’être les mêmes.
Qu’est-ce qui pollue le plus dans l’industrie spatiale ?
Il y a le décollage, avec des douches d’eau pour éviter que la structure qui maintient la fusée à la verticale avant et pendant son lancement, la combustion des carburants, qui au mieux sont très polluants, au pire très toxiques pour la faune humaine et animale et la flore environnante. Côté construction, tout le pan métallurgie est extrêmement polluant. Et si on continue la comparaison avec un avion, qui va être réutilisé pour des centaines de vols pendant des années, une fusée, même réutilisable, a besoin de pièces de remplacement pour chaque nouveau vol. Relativity Space, une entreprise américaine, imprime par exemple ses moteurs en 3D. Ça permet de réduire l’empreinte carbone par rapport à des procédés classiques, surtout que là où les architectures des avions n’évoluent plus vraiment, celles des fusées varient beaucoup, et l’impression 3D permet des itérations, donc des fabrications répétées, beaucoup moins coûteuses et plus rapides.
Quels sont les moyens de diminuer l’impact environnemental du secteur spatial ?
En ce qui concerne les charges utiles placées en orbite, ça va être de rallonger leur durée de vie au maximum, parce que ça permet d’avoir besoin de moins les remplacer. Par exemple en rendant des satellites autonomes en énergie, y compris pour leur propulsion s’il faut ajuster leur orbite, grâce à des panneaux solaires. Dans le cas de satellites d’observation, les optimiser pour les rendre résistants et modulables, comme c’était le cas pour Hubble, qui a eu besoin de missions d’entretien pendant ses plus de trente années de vie, mais qui a pu s’adapter par des mises à jour et quelques remplacements.
Et pour les fusées elles-mêmes, qui sont le pan visible de cette pollution ?
En ce qui concerne les fusées, c’est beaucoup sur les carburants que vont jouer les constructeurs. L’ergol –le nom du carburant des fusées– utilisé pour beaucoup de fusées réutilisables, c’est le méthane. Et le méthane qui brûle, ça troue la couche d’ozone, c’est un cauchemar environnemental. Et il faut le liquéfier et le conserver sous forme liquide –c’est comme ça qu’il est stable– dans les réservoirs. L’hydrogène, qui est beaucoup utilisé comme ergol, ne pollue pas à sa combustion, mais il est extrêmement polluant à obtenir, par processus d’électrolyses, donc de séparation des molécules d’hydrogène dans les molécules d’eau. Isar Aerospace, une entreprise européenne qui a tenté un premier lancement en mars de la fusée qu’ils conçoivent, utilise du propane. Ce sont les premiers à le tenter, c’est moins polluant que le méthane, et la combustion a fonctionné sur leur premier test de lancement, donc ça pourrait être une alternative viable.
Il y a aussi des projets de fabriquer des fusées avec des réservoirs autophages, donc avec un carburant complètement solide sans réservoir en dur autour. Ça permettrait de diminuer le poids de la fusée, donc de consommer moins de carburant, donc de polluer moins, de la construction à la combustion. C’est un projet sur lequel travaillent par exemple des universitaires en Ecosse financés par le gouvernement britannique ; ou l’entreprise franco-italienne Alpha Impulsion.
Et sur la construction, il y a des marges de manœuvre ?
Oui, plein. Rien que de réduire les sites de fabrication pour réduire les transports ferait une différence. C’est l’intérêt d’avoir des sites de lancement sur le continent européen en plus de Kourou, et c’est pour ça que les entreprises du new space ne multiplient pas les sites de fabrication, là où les entreprises comme Airbus et Ariane, qui répondent à des impératifs politiques, doivent s’éparpiller pour que les différents pays actionnaires soient satisfaits. Mais le fait est que le secteur spatial est constitué de plein de petites entreprises qui sous-traitent pour les plus grandes, ce qui implique forcément des acheminements entre les sites de production et d’assemblage.
Il y aussi des choses qui évoluent naturellement, comme utiliser de l’énergie de sources renouvelables pour alimenter les machines, les transporteurs… Ce qu’il est important de garder en tête, c’est que le secteur spatial innove constamment, très vite, et cherche beaucoup à être plus propre, surtout chez les start-ups du new space, qui en font un argument de vente pour attirer des financements et des clients.
Le mot de la fin, est-ce que cette pollution générée par le spatial en vaut la peine ?
C’est un grand débat, comment justifier la pollution des activités humaines. Surtout que dans le cas du spatial, ça ne produit pas directement de richesses, même si ça crée de l’emploi. Il y a l’aspect militaire qui pour les armées justifiera toujours de générer des émissions polluantes ; il y a l’aspect commercial pour les satellites de communication, qui justifie beaucoup de lancements. Pour l’aspect scientifique, c’est assez paradoxal, mais la fabrication et le lancement, qui sont polluants, de satellites d’observation de la Terre, sont incroyablement nécessaires, parce qu’ils permettent ensuite de prouver, observer, analyser et modéliser pour anticiper et s’adapter au changement climatique, qui est loin d’être dû uniquement au secteur spatial.
Un entretien réalisé par Laurence Aubron.