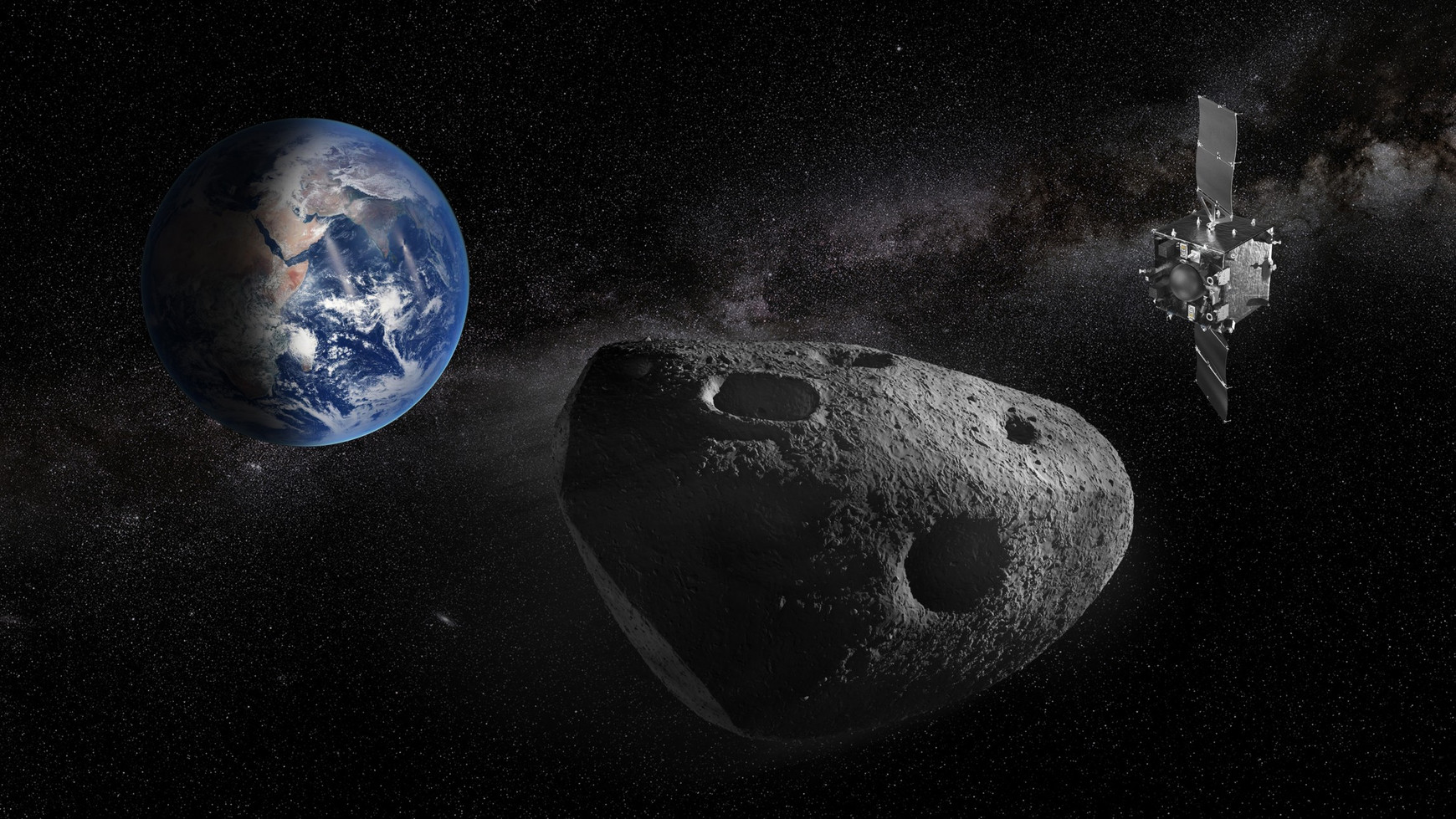
Tous les mercredis, écoutez Iris Herbelot discuter d'un sujet du secteur spatial. Tantôt sujet d'actualité ou bien sujet d'histoire, découvrez les enjeux du programme européen Hermès, de la nouvelle Ariane 6, ou encore de la place de l'Europe dans le programme Artémis. Ici, nous parlons des enjeux stratégiques pour notre continent d'utiliser l'espace pour découvrir, innover, et se défendre.
Nous nous retrouvons pour un sujet que nous avons déjà abordé dans La Guerre des Étoiles : la défense de notre planète face aux astéroïdes géocroiseurs.
C'est une menace qui n'a rien d'imminent, et heureusement d'ailleurs car l'humanité n'est toujours pas prête à se défendre, mais c'est intéressant d'en parler parce qu'outre les missions tests de déviation de trajectoire, comme DART dont nous avions déjà parlé ; la défense planétaire est le fruit de nombreuses coopérations qui, de fait, sont internationales.
Pour rappel, quels sont les risques et les enjeux ?
En fonction de la taille et de la masse de l’astéroïde qui s’écrase sur Terre, les dégâts varient. Généralement les astéroïdes qui s’écrasent le font dans des zones désertes ou très peu peuplées –de fait, nous humains sommes grégaires, et la population mondiale est concentrée dans des poches, notamment les villes. Beaucoup ont été documentés en Sibérie, là encore vu l’immensité du territoire russe, c’est logique que ce soit en Russie que s’écrasent de nombreux astéroïdes. Un bon exemple est celui de la météorite qui a détonné dans l’atmosphère dans l’Oural russe en 2013. Elle faisait 18 mètres de diamètre et neuf mille tonnes, et l’énergie de sa désintégration était 30 fois plus forte que la bombe d’Hiroshima. Les habitants de la région l’ont vu de très loin, ont été aveuglés, la détonation a provoqué une onde de choc qui a brisé des vitres et causé de nombreux blessés sur des kilomètres à la ronde.
C’est le scénario le plus probable qui nous menace, des géocroiseurs qui ne vont pas provoquer une extinction de masse, mais des dégâts matériels et humains considérables. Et pour peu qu’une météorite s’écrase ou détonne sur une ville, les victimes seraient innombrables. En 2013, personne n’a vu venir la météorite, c’est ce qui a poussé à la création d’organismes dédiés et de programmes d’observation et de recensement.
À court et moyen terme, quelles sont les prévisions ?
Un événement prochain va avoir des conséquences indirectes pour nous, puisqu’un astéroïde –nommé 2024 YR4– qui n’est pas géocroiseur à proprement parler va peut-être s’écraser sur notre satellite naturel, la Lune. Le soleil nous empêche de l’observer en ce moment, on pourra à nouveau le scruter en 2028. Il y a 4% de chances qu’il s’écrase sur la Lune, et s’il venait à s’écraser sur la face lunaire qui nous est visible, l’impact créerait des projectiles qui pourraient gravement endommager les systèmes humains que nous avons en orbite et dont nous dépendons au quotidien. Sans parler des astronautes potentiellement en mission pour Artémis ou des stations en orbite terrestre. Ce ne sont que des suppositions, et les risques sont faibles, mais c’est le genre d’incertitude et d’impossibilité d’observation qui nous montre qu’il faut rester prudent et réactif.
Quels sont les acteurs-clés de la défense planétaire pour évaluer les risques d’impact avec la Terre ?
En premier lieu il y a bien sûr les agences spatiales qui déterminent la gravité de la menace, au premier rang desquels la NASA.
Au quotidien, ce sont des observatoires qui scrutent et cataloguent les NEO, les objets proches de la Terre. Parmi eux il y a le réseau d’observatoires ATLAS, qui dispose de quatre observatoires sur les deux hémisphères. Les différents observatoires dans le monde ne communiquent pas nécessairement entre eux, mais les agences spatiales ont un rôle efficace de mise en commun des différentes observations, particulièrement par le biais du IAWN depuis sa création sur recommandation de l’ONU, qui est le réseau international d’alerte sur les astéroïdes.
L’ESA dispose aussi de son propre réseau de télescopes, les Flyeye, qui scannent et cartographient le ciel à la recherche de NEO toutes les nuits. En plus, l’ESA prévoit de lancer au début des années 2030 NEOMIR, un télescope spatial qui sera placé entre le Soleil et nous pour repérer les astéroïdes dangereux pour la Terre.
Et qui prend en charge le processus décisionnel s’il s’avérait qu’un astéroïde géocroiseur était une menace sérieuse ?
C’est le SMPAG qui est en charge. C’est un groupe sous la houlette de l’ONU créé après les événements de 2013, qui sert de forum pour les agences spatiales nationales –et l’ESA dans le cas de l’Europe– et qui a la responsabilité de coordonner la ou les réponses à une menace d’un impact potentiel.
S’il est saisi, ç’a par exemple été le cas pour 2024 YR4 avant que la menace ne soit écartée en affinant les modèles grâce à des observations, le SMPAG évalue la gravité de la menace et détermine s’il est nécessaire d’agir ou non. Pour que le niveau de gravité soit retenu, il faut que l’astéroïde géocroiseur fasse plus de 50 mètres de diamètre et ait plus d’1% de chances d’impact avec la Terre.
Si le SMPAG décide qu’il faut agir –pour l’instant c’est un scénario qui n’a jamais eu lieu–, il peut déclencher des missions spatiales pour aller étudier, dévier ou détruire l’astéroïde géocroiseur.
Un entretien réalisé par Laurence Aubron.






