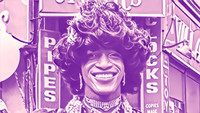Avec sa chronique Les femmes ou les "oublis" de l'Histoire, Juliette Raynaud explore "les silences de l'Histoire" (Michelle Perrot) et nous invite à (re)découvrir notre matrimoine oublié, une histoire après l'autre...
Vous connaissez Angélique du Coudray ?
Sage-femme enseignante, elle forma près de 5000 sage-femmes en une trentaine d’années de carrière au 18e siècle. Cible d’un mépris de classe et de genre à la hauteur de sa compétence et de sa valeur, elle oeuvra pour professionnaliser le métier de sage-femme, une pratique de soin séculaire encore trop peu reconnue (entendre « correctement rémunérée »).
Si la confiance demeure le critère principal du choix des accompagnantes lors d’un accouchement dans la France des années 1750, l’idée qu’il faut ajouter un savoir et une pratique progresse. L’accent est mis sur la formation des sage-femmes.
L’Hôtel-Dieu de Paris héberge la seule école de sage-femmes européenne depuis le 14e siècle mais c’est surtout de manière interpersonnelle que se transmettent « les arts de l’accouchement ». Bien sûr, les sage-femmes sont de la partie mais traditionnellement, ce sont les « matrones », des femmes de la famille ou des voisines, qui accompagnement les accouchements. Dans les grandes villes, il y a aussi de plus en plus de chirurgiens qui se réservent les interventions actives sur le corps des femmes à l’aide d’instruments.
Angélique du Coudray naît en 1710 en Auvergne. A 27 ans, elle monte à Paris se former auprès d’une sage-femme jurée, c’est-à-dire enregistrée au Châtelet de Paris. Après une formation de deux ans, Angélique devient à son tour sage-femme jurée.
Pendant une quinzaine d’années, elle exerce à Paris pour une clientèle assez aisée issue de la bourgeoisie parisienne voire de la noblesse. La profession d’accoucheuse peut être une profession honorable. Si l’on est reconnue et que l’on a accès à une clientèle fortunée, on peut vivre de ce métier.
Angélique fait de son savoir le support d’une véritable carrière et connaît un certain prestige social à partir de 1750. Elle obtient des soutiens majeurs tel que celui de Necker, et un brevet royal qui lui permet d’exercer dans n’importe quel point du royaume. Sa réputation la précède : en 1755, elle est contactée par le seigneur de Thiers en Auvergne pour devenir sage-femme dans sa seigneurie.
Angélique prend rapidement conscience de la grande ignorance des matrones rurales en matière d’anatomie. C’est là que commence sa carrière d’enseignante.
Dans un premier temps, elle les forme de manière traditionnelle et mobilise un vocabulaire scientifique. C’est un échec. Elle comprend qu’elle va devoir mettre en oeuvre des techniques de démonstration pour leur montrer ce qu’il faut faire et surtout ce qu’il ne faut pas faire. Elle s’appuie alors sur un mannequin en tissu de son invention : un tronc de femme de la taille au milieu des cuisses. Elle a également trois petites poupées (un foetus à terme et deux jumeaux à 7 mois de grossesse) et un faux placenta. Au-delà de la transmission théorique de connaissances, Angélique du Coudray forme par la pratique dans « les conditions du réel » : ses élèves ne voient pas ce qui se passe dans le ventre en tissu du mannequin et doivent tout identifier au toucher.
Il y a une rupture sociale entre le savoir jusqu’alors gardé sous la forme de traités savants – souvent réservés aux hommes - et la formation d’Angélique du Coudray : c’est le premier exemple de vulgarisation pédagogique. Elle sait s’adapter au niveau de ses élèves, qu’elles sachent lire pour pouvoir se référer aux planches de son Abrégé des arts de l’accouchement édité en 1759, ou qu’elles apprennent par la pratique sur le mannequin.
Les élites royales – constituées d’hommes – sont convaincues de la nécessité de former des sage-femmes et reconnaissent à Angélique une parfaite compétence dans son domaine mais le mépris de classe et de genre est considérable. Ils lui reprochent sa « vanité », sa recherche « d’éloges » et la qualifient de « ridicule ».
De fait, ultra-compétente, Angélique du Coudray ne cède pas sur la reconnaissance qu’elle mérite. Elle a de quoi les contrarier : elle veut être payée pour exercer son métier !
Consciente de sa valeur professionnelle et pédagogique, elle estime qu’elle doit être correctement logée, nourrie et éclairée ; pouvoir s’installer une quinzaine de jours avant de commencer ses cours et avoir quinze jours de repos après ses cours ; se déplacer en voiture conduite par quatre chevaux. Elle demande à ce qu’on lui achète un certain nombre d’exemplaires de ses manuels ainsi qu’un mannequin de son invention pour les mettre à disposition de ses élèves.
Elle obtient aussi que chacun de ses cours aboutisse à la délivrance d’un certificat. Angélique du Coudray est pionnière dans la mise au point d’une formation diplômante mêlant théorie et pratique. L’exclusivité d’exercice ne sera acquise qu’au début du 19e siècle, on voit déjà le corps professionnel des sage-femmes se constituer.
Angélique du Coudray forme près de 5 000 sage-femmes en une trentaine d'années d'itinérance dans les différentes provinces françaises.
En 1783, elle se retire à Bordeaux auprès de sa nièce, Marguerite Coutanceau qui sera l’une des seules sage-femmes à avoir le titre de « professeur d’accouchement » au 19e siècle et aura à coeur de faire de l’examen de ses élèves une grande cérémonie en présence des élites locales.
Pour aller plus loin : L'école des sages-femmes: naissance d'un corps professionnel, 1786-1917, Nathalie Sage-Pranchère