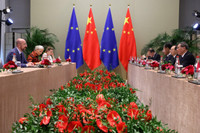Dans leurs chroniques sur euradio, Jeanette Süß et Marie Krpata dressent un état des lieux des relations franco-allemandes et de la place de la France et de l’Allemagne au sein de l’UE et dans le monde. Elles proposent d’approfondir des sujets divers, de politique intérieure, pour mieux comprendre les dynamiques dans les deux pays, comme de politique étrangère pour mieux saisir les leviers et les freins des deux côtés du Rhin.
Friedrich Merz et dix ministres de son équipe se sont rendus à Toulon le 29 août pour participer au Conseil des ministres franco-allemand avec leurs homologues français. Nous en parlons avec Jeanette SüS, chercheuse au Comité d’études des relations franco-allemandes à l’Ifri.
Ce Conseil des Ministres était-il un exercice uniquement symbolique, ou est-ce que ces pourparlers ont eu une véritable utilité ?
Les symboles ont toujours eu une grande importance dans la relation franco-allemande. C’est d’ailleurs ce qui a souvent manqué sous le précédent gouvernement allemand : on pouvait presque parler d’un « je t’aime, moi non plus ».
Mais ce Conseil des ministres allait bien au-delà du symbole : il s’agissait d’élaborer plusieurs feuilles de route concrètes pour relancer le moteur franco-allemand dans différents domaines politiques. Les groupes de travail entre ministères allemands et français ont produit des documents thématiques avec des mesures précises, par exemple dans le domaine spatial, autour de l’organisation d’un congrès sur la souveraineté numérique ou encore la mise en place d’une union de l’épargne.
Il s’agit d’une feuille de route ambitieuse, mais les défis ne manquent pas, et nous avons aujourd’hui plus que jamais besoin d’un moteur franco-allemand qui prenne les choses en main.
Plus concrètement, de quoi a-t-il été question lors du Conseil des ministres franco-allemand de cette année à Toulon ?
Le chancelier Merz a salué l’« excellent travail d’équipe » des dernières semaines. Il a insisté sur le rôle de leadership assumé conjointement par l’Allemagne et la France, tout en associant étroitement l’Ukraine, les États-Unis et l’ensemble des partenaires européens – grands ou petits, occidentaux comme orientaux. Toutefois, Merz et Macron ont souligné les difficultés concernant la Russie qui bloque complètement des pourparlers pour une mise en place d’un cessez-le-feu. Réfléchir conjointement sur les garanties de sécurité pour l’Ukraine ainsi que sanctionner davantage la Russie seront l’élément central pour les semaines et mois à venir.
Le renforcement des capacités européennes en matière de sécurité et de défense a occupé une place centrale dans les travaux du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Merz a précisé qu’il ne s’agissait pas de remplacer l’OTAN, mais bien de consolider son pilier européen.
Enfin, la compétitivité économique de l’Europe a été définie comme un objectif prioritaire. Le chancelier a réaffirmé sa volonté de promouvoir une croissance durable, des entreprises solides et des emplois attractifs, ce qui implique un changement de cap économique. C’est dans cette optique qu’un nouvel agenda économique franco-allemand a été adopté à Toulon, afin de doter l’Union européenne d’une base plus robuste face à la concurrence mondiale.
Cela paraît assez complet. Quels sont désormais les principaux obstacles à sa mise en œuvre ?
Le 8 septembre aura lieu le vote de confiance demandé par le Premier ministre François Bayrou. À l’heure actuelle, il est très probable que le gouvernement français tombe, ce qui entraînera inévitablement des répercussions sur les relations bilatérales. Certes, l’administration et les équipes techniques resteront largement en place, mais pour porter de véritables projets politiques communs, il faut un soutien ministériel fort. Seuls les grands dossiers, comme la guerre en Ukraine et les questions de défense, pourraient être pilotés directement par Emmanuel Macron, qui restera sans doute président.
Nous allons donc entrer dans une phase de transition et d’incertitude, en espérant que les équipes en coulisses continueront à travailler sur les dossiers en attendant un retour à la stabilité politique en France. Mais la fenêtre d’opportunité est étroite : dès 2027, auront lieu les prochaines élections présidentielles en France. C’est donc maintenant qu’il faut agir.
Un entretien réalisé par Laurence Aubron.
Licence de l'image : CC BY-SA 4.0